| Élément | |
|---|---|
85AtAstate209.98712
8 18 32 18 7 |
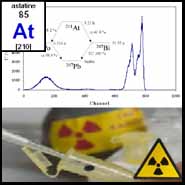
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 85 |
| Masse atomique | 209.9871 amu |
| Famille d'éléments | Halogènes |
| Période | 6 |
| Groupe | 17 |
| Bloc | p-block |
| Année découverte | 1940 |
| Distribution des isotopes |
|---|
| Aucun |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 7 g/cm3 (STP) |
H (H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 302 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 337 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | -1, +1 (+3, +5, +7) |
| Potentiel de première ionisation | 9.535 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | 2.416 eV |
Nobelium (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 2.2 |
Césium (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| Configuration électronique | [Xe] 4f14 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 7 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Astate (At) : Élément du tableau périodique
Résumé
L'astate (At) représente l'élément naturel le plus rare de la croûte terrestre, occupant le numéro atomique 85 dans le groupe des halogènes du tableau périodique. Tous les isotopes de l'astate présentent une instabilité radioactive extrême, le plus stable étant le 210At avec une demi-vie de seulement 8,1 heures. Cette désintégration radioactive empêche la formation d'échantillons macroscopiques, car toute quantité détectable s'évapore immédiatement en raison du chauffage radiatif intense. L'élément démontre des propriétés chimiques uniques qui combinent caractéristiques halogénées et métalliques, avec une électronégativité de 2,2 sur l'échelle de Pauling et la capacité de former des espèces anioniques et cationiques en solution. Sa réactivité chimique s'avère moindre que celle de l'iode, en faisant le halogène le moins réactif. Les applications industrielles se limitent à des domaines spécialisés de la médecine nucléaire, notamment la thérapie par particules alpha ciblées utilisant le 211At. L'élément a été découvert en 1940 par synthèse artificielle à l'Université de Californie à Berkeley, par bombardement du bismuth-209 avec des particules alpha.
Introduction
L'astate occupe une position particulière dans le tableau périodique en tant qu'halogène naturel le plus lourd, représentant l'élément 85 du groupe 17. Sa configuration électronique [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 en fait le dernier membre des halogènes naturels, avec des propriétés intermédiaires entre la chimie halogénée classique et les caractéristiques métalliques émergentes. Sa rareté exceptionnelle provient de son instabilité radioactive totale, l'abondance terrestre estimée étant inférieure à un gramme présent dans toute la croûte terrestre à un moment donné.
Les prédictions théoriques basées sur les tendances périodiques indiquent que l'astate devrait posséder l'énergie d'ionisation la plus faible parmi les halogènes stables, environ 899 kJ mol-1, poursuivant la tendance décroissante observée du fluor (1681 kJ mol-1) à l'iode (1008 kJ mol-1). Sa position proche de la frontière métalloïde-métal introduit des caractéristiques de liaison distinctes de celles des halogènes plus légers. La découverte de l'astate par synthèse artificielle en 1940 par Corson, MacKenzie et Segrè a confirmé son existence, bien que sa présence naturelle ait été ultérieurement vérifiée en quantités infimes dans les séries de désintégration de l'uranium et de l'actinium.
Propriétés physiques et structure atomique
Paramètres atomiques fondamentaux
La structure atomique de l'astate repose sur un noyau contenant 85 protons, définissant sa place dans le tableau périodique et son identité chimique. Sa configuration électronique [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 montre un électron non apparié dans l'orbitale 6p externe, cohérent avec les caractéristiques des halogènes. Les mesures du rayon atomique indiquent des valeurs proches de 150 pm, représentant le plus grand rayon atomique parmi les halogènes naturels, reflétant une charge nucléaire effective diminuée due à l'effet d'écrantage électronique.
Le rayon ionique de l'astate dans l'état d'oxydation -1 atteint environ 227 pm pour At-, nettement supérieur à celui de l'ion iodure (220 pm), confirmant la tendance périodique d'augmentation de la taille ionique au sein du groupe des halogènes. Les calculs de charge nucléaire effective montrent une attraction réduite pour les électrons de valence due à l'écrantage complet des couches internes, influençant sa réactivité chimique unique. Les valeurs de polarisabilité surpassent significativement celles de l'iode, accentuant sa propension à former des liaisons covalentes et des comportements métalliques sous certaines conditions.
Caractéristiques physiques macroscopiques
L'apparence physique de l'astate reste principalement théorique en raison de l'impossibilité d'obtenir des quantités macroscopiques pour observation directe. Les extrapolations des tendances périodiques des halogènes suggèrent un solide sombre et brillant à caractère métallique, contrairement aux cristaux moléculaires typiques des halogènes légers. Les prédictions sur la structure cristalline indiquent soit des arrangements orthorhombiques similaires à l'iode, soit des structures métalliques cubiques à faces centrées, selon les conditions thermodynamiques et les méthodes de préparation.
Les températures de fusion estimées varient entre 575 K et 610 K (302°C à 337°C), représentant le point de fusion le plus élevé du groupe des halogènes, lié à des forces intermoléculaires renforcées. Les points d'ébullition extrapolés suggèrent des valeurs entre 610 K et 650 K (337°C à 377°C), bien que ces estimations soient très spéculatives en raison de l'instabilité radioactive. Les calculs de densité pour l'astate métallique prévoient des valeurs entre 8,91 et 8,95 g cm-3, nettement supérieures à celle de l'iode (4,93 g cm-3) et s'approchant des densités des métaux de transition.
Les mesures de pression de vapeur montrent une volatilité réduite comparée à l'iode, les taux de sublimation étant environ deux fois plus faibles dans des conditions similaires. Cette volatilité moindre s'explique par des forces intermoléculaires accrues et des caractéristiques potentielles de liaison métallique. Les estimations de la capacité thermique spécifique donnent des valeurs proches de 0,17 J g-1 K-1, cohérentes avec les propriétés thermiques des éléments lourds et les comportements métalliques.
Propriétés chimiques et réactivité
Structure électronique et comportement de liaison
La réactivité chimique de l'astate découle de sa configuration électronique unique permettant des modes de liaison à la fois halogénés et métalliques. L'électron 6p non apparié participe facilement à des liaisons covalentes, tandis que son nuage électronique étendu montre une polarisabilité accrue comparée aux halogènes légers. Les états d'oxydation courants incluent -1, +1, +3, +5 et +7, le +1 présentant une stabilité particulière qui distingue l'astate des autres halogènes.
Les caractéristiques de liaison révèlent des longueurs de liaison At-H proches de 171 pm dans l'astatide d'hydrogène, représentant la liaison hydrogène-halogène la plus longue et reflétant une force de liaison diminuée. Les liaisons covalentes avec le carbone produisent des longueurs At-C atteignant 220 pm, nettement supérieures aux liaisons carbone-iode correspondantes. La propension à former des liaisons covalentes augmente relativement aux autres halogènes, cohérent avec une électronégativité réduite et un caractère métallique accentué.
La chimie de coordination démontre sa capacité à former des complexes stables avec divers ligands, incluant des composés avec la pyridine et autres donneurs azotés. Le nombre de coordination varie généralement entre 2 et 6, avec des géométries planes carrées ou octaédriques observées selon les environnements chimiques. Les schémas d'hybridation impliquent principalement des configurations sp3d2 dans les complexes à haute coordination, permettant des géométries complexes inaccessibles aux halogènes légers.
Propriétés électrochimiques et thermodynamiques
Les valeurs d'électronégativité de l'astate atteignent 2,2 sur l'échelle de Pauling, la plus faible parmi les halogènes naturels et proche de celle de l'hydrogène. Cette électronégativité réduite reflète sa position près de la frontière métal-non métal et influence son comportement chimique. Sur l'échelle d'Allred-Rochow, les valeurs s'approchent de 1,9, soulignant davantage sa faible capacité d'attraction électronique.
Les mesures d'énergie d'ionisation confirment la tendance périodique décroissante au sein du groupe des halogènes, avec une première énergie d'ionisation d'environ 899 kJ mol-1. Cette valeur permet une extraction d'électron facilitée comparée aux autres halogènes, favorisant la formation de cations dans des environnements chimiques appropriés. Les énergies d'ionisation suivantes respectent les schémas attendus, avec une seconde énergie proche de 1600 kJ mol-1, les valeurs supérieures reflétant l'arrachement des électrons internes.
Les données d'affinité électronique indiquent des valeurs de 233 kJ mol-1, représentant une réduction d'environ 21% par rapport à l'iode (295 kJ mol-1). Cette diminution provient des effets de couplage spin-orbite qui déstabilisent l'électron supplémentaire dans l'anion At-. Les potentiels de réduction standards pour le couple At2/At- mesurent environ +0,3 V, indiquant un comportement oxydant modéré. Le couple At+/At présente des potentiels proches de +0,5 V, démontrant sa capacité à exister dans plusieurs états d'oxydation en solution.
Composés chimiques et formation de complexes
Composés binaires et ternaires
L'astatide d'hydrogène (HAt) constitue le composé binaire le plus simple, formé par combinaison directe de l'astate avec l'hydrogène ou par protonation de solutions d'astatide. Contrairement aux autres halogénures d'hydrogène, HAt présente une polarité unique avec une localisation de la charge négative sur l'hydrogène plutôt que sur l'astate, reflétant son électronégativité réduite. Le composé montre des propriétés réductrices accentuées et s'oxyde facilement en milieu acide.
Les composés interhalogènes incluent AtI, AtBr et AtCl, formés par réactions en phase vapeur ou chimie en solution avec des sources halogénées appropriées. Ces composés démontrent une stabilité supérieure aux prédictions thermodynamiques, suggérant des effets de stabilisation cinétique. AtI présente une stabilité particulière et sert d'intermédiaire synthétique dans divers préparations chimiques. Des anions complexes comme AtI2- et AtBr2- se forment facilement en solution, révélant une chimie de coordination élargie.
Les astatides métalliques incluent l'astatide de sodium (NaAt), l'astatide d'argent (AgAt) et l'astatide de thallium (TlAt), montrant des caractéristiques de liaison ionique avec des énergies réticulaires intermédiaires entre les iodures correspondants et les composés métalliques théoriques. Ces composés présentent des solubilités variables, l'astatide d'argent montrant une solubilité limitée cohérente avec sa position dans la série des solubilités des halogénures d'argent. L'astatide de plomb (PbAt2) et ses dérivés démontrent une stabilité thermodynamique permettant leur utilisation dans des réactions de précipitation pour la séparation et la purification de l'astate.
Chimie de coordination et composés organométalliques
Les complexes de coordination illustrent la versatilité de l'astate en tant que ligand et atome central. Le cation dipyridine-astate(I) [At(C5H5N)2]+ adopte une géométrie linéaire avec des liaisons covalentes dative reliant l'astate aux atomes d'azote donneurs. Ce cation forme des sels stables avec divers anions comme le perchlorate et le nitrate, démontrant sa capacité à agir comme centre de coordination.
La chimie organométallique inclut l'astatobenzène (C6H5At) et ses dérivés aromatiques formés par réactions de substitution électrophile. Ces composés montrent une stabilité accrue comparée aux dérivés alkyles simples grâce à l'effet de stabilisation aromatique. L'oxydation de l'astatobenzène produit des composés comme C6H5AtCl2 et C6H5AtO2, révélant sa participation aux voies de synthèse organique.
La formation de complexes avec l'EDTA et autres agents chélatants montre sa capacité à créer des composés de coordination stables avec des ligands polydentés. Ces complexes présentent des constantes de stabilité comparables à celles des complexes d'argent(I), reflétant des rapports charge/taille similaires et des préférences de coordination analogues. Ces complexes sont particulièrement importants pour les applications radiochimiques et les techniques de séparation de l'astate.
Présence naturelle et analyse isotopique
Distribution géochimique et abondance
L'astate possède l'abondance crustale la plus faible parmi les éléments naturels, avec une quantité totale estimée inférieure à un gramme dans toute la croûte terrestre à l'équilibre. Cette extrême rareté provient de son instabilité radioactive totale et de l'absence d'isotopes à longue durée de vie pouvant s'accumuler sur des échelles géologiques. Sa présence naturelle se limite à des traces produites continuellement par la désintégration radioactive d'éléments plus lourds dans les séries de l'uranium, de l'actinium et du neptunium.
Les schémas de comportement géochimique suggèrent que l'astate devrait se concentrer dans les environnements riches en sulfures et présenter des caractéristiques chalcophiles similaires aux autres halogènes lourds. Cependant, sa demi-vie courte empêche tout processus significatif de concentration géochimique, limitant sa distribution aux zones proches des désintégrations de ses noyaux parents. Les environnements marins pourraient contenir des concentrations légèrement supérieures dues à la désintégration continue des espèces uraniques dissoutes, bien que les concentrations restent inférieures à 10-20 mol L-1 dans la plupart des conditions.
Les associations minérales restent largement théoriques en raison de son instabilité radioactive. Les associations prévues incluent les minerais uranifères comme la pechblende et la carnotite, où les isotopes d'astate se forment comme produits intermédiaires de désintégration. Sa polarisabilité élevée suggère une association potentielle avec les minerais de sulfures en conditions d'équilibre, bien que ces associations ne puissent persister en raison de sa désintégration rapide.
Propriétés nucléaires et composition isotopique
Les isotopes naturels incluent 215At, 217At, 218At et 219At, tous avec des demi-vies mesurées en secondes ou minutes. L'isotope 219At possède la demi-vie naturelle la plus longue à 56 secondes, apparaissant dans la série de désintégration de l'actinium comme produit de désintégration du francium-223. Ces isotopes subissent principalement une désintégration alpha, produisant des descendants bismuth et polonium.
Les isotopes synthétiques couvrent des masses allant de 193 à 223, le 210At étant l'isotope le plus stable malgré sa demi-vie de 8,1 heures. Cet isotope se désintègre principalement par alpha (99,8%) avec une capture électronique mineure (0,2%), produisant respectivement du polonium-206 et du bismuth-210. Le 211At possède une importance particulière pour les applications médicales en raison de sa demi-vie de 7,2 heures et de sa désintégration alpha pure.
Les sections efficaces nucléaires pour la production d'isotopes d'astate impliquent généralement des cibles de bismuth-209 bombardées par des particules alpha, protons ou neutrons. La réaction 209Bi(α,2n)211At constitue la méthode principale pour les isotopes médicaux, nécessitant des énergies de particules alpha proches de 28 MeV pour un rendement optimal. D'autres méthodes incluent 232Th(p,20n)213At et des réactions de spallation associées, bien que moins efficaces pour les applications pratiques.
Production industrielle et applications technologiques
Méthodes d'extraction et de purification
La production industrielle de l'astate repose exclusivement sur la synthèse artificielle par réactions nucléaires, les quantités naturelles étant insuffisantes pour les applications pratiques. La méthode principale consiste à bombarder des cibles de bismuth-209 avec des particules alpha de 28-30 MeV dans des cyclotrons, générant du 211At via la voie de réaction (α,2n). La préparation des cibles nécessite du bismuth métallique de haute pureté déposé sur des supports en cuivre ou aluminium pour faciliter l'évacuation de la chaleur pendant le bombardement.
Les procédures de purification doivent s'accomplir rapidement en raison des demi-vies courtes, souvent en quelques heures après production. Les méthodes de distillation exploitent les différences de volatilité entre l'astate et le bismuth, généralement conduites à 200-300°C sous pression réduite. Alternativement, l'extraction chimique humide utilise du chloroforme ou du tétrachlorure de carbone pour séparer l'astate des matériaux de cible dissous.
La chromatographie d'échange d'ions permet une séparation sélective grâce à des résines spécialisées exploitant ses caractéristiques d'adsorption uniques. Les résines cationiques s'avèrent particulièrement efficaces pour séparer les espèces At+ des contaminants bismuth et métaux. Le rendement global de production dépasse rarement 10-15% en raison des réactions nucléaires concurrentes et des pertes durant la séparation. La capacité mondiale reste limitée à des quantités de recherche, généralement exprimées en millicuries pour des applications spécialisées.
Applications technologiques et perspectives futures
Les applications médicales constituent l'utilisation principale de l'astate, spécifiquement le 211At pour la thérapie par particules alpha ciblées en oncologie. Sa demi-vie de 7,2 heures offre un délai suffisant pour la préparation de radiopharmaceutiques et le traitement des patients, tout en minimisant l'exposition radioactive à long terme. Les particules alpha émises déposent une radiation à transfert linéaire d'énergie élevé à l'échelle cellulaire, permettant la destruction sélective des tissus cancéreux avec un dommage minimal aux cellules saines environnantes.
Les applications de recherche incluent l'utilisation d'astate comme traceur radioactif pour étudier la chimie des halogènes et les processus biochimiques. Sa position unique parmi les halogènes permet d'explorer les tendances périodiques et les théories de liaison chimique dans des conditions extrêmes. La physique nucléaire l'utilise pour étudier les mécanismes de désintégration alpha et les effets de structure nucléaire dans les noyaux lourds.
Les perspectives futures incluent le développement de méthodes de production améliorées pour accroître la disponibilité isotopique. La production par accélérateur avec des particules à haute énergie pourrait améliorer les rendements en réduisant les réactions concurrentes. Les recherches sur des matériaux cibles alternatifs et des voies réactionnelles nouvelles visent à surmonter les limitations actuelles. Les technologies de séparation avancées, incluant des systèmes automatisés à purification rapide, constituent un domaine de développement en cours.
Les contraintes économiques limitent actuellement les applications de l'astate aux domaines spécialisés en raison des coûts élevés de production et de sa rareté. Le prix atteint plusieurs milliers de dollars par millicurie, reflétant l'équipement spécialisé et l'expertise nécessaires pour manipuler les matières radioactives. La demande reste limitée par les réglementations et la nécessité d'installations adaptées à la gestion des radioisotopes émetteurs alpha.
Développement historique et découverte
Les fondements théoriques de l'astate remontent à l'organisation du tableau périodique par Dmitri Mendeleev en 1869, qui avait prédit un élément sous l'iode au groupe 17. Cet élément hypothétique, nommé "eka-iode", devait présenter des propriétés intermédiaires entre l'iode et l'halogène plus lourd attendu. Les premières recherches infructueuses incluent les affirmations de Fred Allison en 1931, qui proposa le nom "alabamine" à partir de preuves spectroscopiques ultérieurement invalidées.
Des découvertes présumées incluent l'identification du "dakin" par Rajendralal De en 1937 dans la série de désintégration du thorium, et les observations spectroscopiques des rayons X de Horia Hulubei en 1936 et 1939 menant au nom proposé "dor". Ces premières affirmations souffraient d'une sensibilité insuffisante des méthodes de détection et de l'impossibilité de caractériser chimiquement l'élément. L'annonce de Walter Minder en 1940 du "helvetium" comme produit de désintégration bêta du polonium-218 fut réfutée par des études expérimentales ultérieures.
La synthèse définitive eut lieu en 1940 lorsque Dale Corson, Kenneth MacKenzie et Emilio Segrè à l'Université de Californie à Berkeley produisirent avec succès de l'astate-211 par bombardement alpha du bismuth-209. Leur synthèse cyclotronique fournit des quantités suffisantes pour caractérisation chimique, confirmant ses propriétés halogénées tout en révélant des caractéristiques métalliques uniques. Les découvreurs retardèrent initialement la proposition de nom, reflétant les incertitudes contemporaines sur la validité des éléments synthétisés artificiellement.
La reconnaissance de l'astate en tant qu'élément progressa dans les années 1940 lorsque des méthodes de détection améliorées confirmèrent sa présence naturelle dans les séries de désintégration de l'uranium et de l'actinium. L'identification de Berta Karlik et Traude Bernert en 1943 dans des chaînes de désintégration naturelles valida son existence au-delà de la synthèse artificielle. Le nom "astate", dérivé du grec "astatos" signifiant instable, fut officiellement proposé en 1947, reflétant son instabilité radioactive fondamentale. Cette dénomination poursuit la tradition halogène de noms descriptifs basés sur des propriétés caractéristiques, parallèlement au chlore (vert), au brome (odeur forte) et à l'iode (violet).
Conclusion
L'astate occupe une position unique dans le tableau périodique en tant qu'halogène naturel terminal, combinant des propriétés chimiques intermédiaires entre les halogènes classiques et les caractéristiques métalliques émergentes. Son instabilité radioactive extrême, tous isotopes possédant des demi-vies inférieures à quelques heures, empêche la formation d'échantillons macroscopiques et limite les mesures physiques directes. Cependant, les prédictions théoriques et les études chimiques à l'échelle de trace révèlent une chimie complexe avec une électronégativité réduite, une propension accrue aux liaisons covalentes et la capacité de former des espèces anioniques et cationiques.
Les applications technologiques actuelles se limitent à la médecine nucléaire spécialisée et à la recherche, principalement avec le 211At pour la thérapie alpha ciblée. Sa production nécessite des cyclotrons sophistiqués et des procédures de purification rapides, limitant sa disponibilité à des quantités de recherche. Les développements futurs en efficacité de production et technologie de séparation pourraient étendre ses applications pratiques, bien que son instabilité radioactive fondamentale restreigne toujours son utilisation à grande échelle. L'astate revêt une importance qui dépasse ses applications immédiates, contribuant à la compréhension des tendances périodiques, des théories de liaison chimique et du comportement de la matière sous les conditions extrêmes imposées par sa composition nucléaire lourde et son instabilité radioactive.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
