| Élément | |
|---|---|
78PtPlatine195.08492
8 18 32 17 1 |
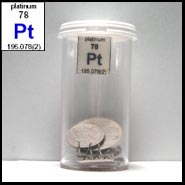
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 78 |
| Masse atomique | 195.0849 amu |
| Famille d'éléments | Les métaux de transition |
| Période | 6 |
| Groupe | 1 |
| Bloc | s-block |
| Année découverte | 600 BC |
| Distribution des isotopes |
|---|
192Pt 0.79% 194Pt 32.9% 195Pt 33.8% 196Pt 25.3% 198Pt 7.2% |
192Pt (0.79%) 194Pt (32.90%) 195Pt (33.80%) 196Pt (25.30%) 198Pt (7.20%) |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 21.46 g/cm3 (STP) |
(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 1772 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 3827 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | +2, +4 (-3, -2, -1, 0, +1, +3, +5, +6) |
| Potentiel de première ionisation | 9.017 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | 2.125 eV |
Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 2.28 |
Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |
| Rayon atomique | |
|---|---|
| Rayon covalent | 1.23 Å |
(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |
| Van der Waals rayon | 1.75 Å |
(H) 1.2 Francium (Fr) 3.48 | |
| Rayon métallique | 1.39 Å |
Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |
| Composés | ||
|---|---|---|
| Formule | Nom | État d'oxydation |
| PtSm | Platine-samarium | -2 |
| K2PtCl4 | Tétrachloroplatinate de potassium | +2 |
| PtCl2 | Chlorure de platine(II) | +2 |
| Pt(CNO)2 | Fulminate de platine | +2 |
| PtF2 | Fluorure de platine (II) | +2 |
| PtI2 | Iodure de platine (II) | +2 |
| K2PtCl6 | Hexachloroplatinate de potassium | +4 |
| PtO2 | Oxyde de platine (IV) | +4 |
| PtCl4 | Chlorure de platine (IV) | +4 |
| Na2PtCl6 | Hexachloroplatinate de sodium | +4 |
| PtBr4 | Bromure de platine (IV) | +4 |
| PtF6 | Hexafluorure de platine | +6 |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| Configuration électronique | [Xe] 4f14 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 10 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Platine (Pt) : Élément du tableau périodique
Résumé
La platine présente une inertie chimique exceptionnelle et une remarquable résistance à la corrosion, ce qui en fait l'un des métaux nobles les plus importants en chimie moderne. Avec le numéro atomique 78 et une masse atomique de 195,084 u, la platine appartient au groupe 10 du tableau périodique et démontre des états d'oxydation variés allant de −2 à +10. L'élément manifeste des propriétés catalytiques exceptionnelles dans de nombreux processus industriels, notamment les systèmes de contrôle des émissions automobiles et les opérations de raffinage pétrolier. Sa structure cristalline adopte un réseau cubique à faces centrées avec une densité de 21,45 g/cm³, largement supérieure à celle de la plupart des métaux courants. La platine naturelle se trouve principalement sous forme de dépôts natifs dans des minerais sulfurés, les réserves mondiales étant concentrées dans le Complexe de Bushveld en Afrique du Sud et la région de Norilsk en Russie.
Introduction
La platine occupe la position atomique 78 dans le tableau périodique, caractérisée par sa configuration électronique [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹. Cette organisation électronique contribue à sa stabilité exceptionnelle et à sa résistance chimique. L'élément appartient aux métaux du groupe platine (PGMs), définis par des propriétés chimiques similaires et des schémas d'occurrence géologique communs. La découverte de la platine remonte aux civilisations sud-américaines précolombiennes, bien que son étude systématique n'ait commencé qu'au XVIIIe siècle après la documentation formelle d'Antonio de Ulloa en 1748. Le rayon métallique mesure 1,39 Å, tandis que les rayons ioniques varient considérablement selon l'état d'oxydation, de 0,86 Å pour Pt²⁺ à 0,77 Å pour Pt⁴⁺. Ces caractéristiques dimensionnelles influencent directement la chimie de coordination et le comportement catalytique.
Propriétés physiques et structure atomique
Paramètres atomiques fondamentaux
La structure atomique de la platine présente une configuration électronique [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹, avec des valeurs de charge nucléaire effective de 10,38 pour l'orbitale 6s et 8,85 pour les orbitales 5d. L'énergie de première ionisation mesure 870 kJ/mol, suivie des énergies de seconde et troisième ionisation de 1791 kJ/mol et 2800 kJ/mol respectivement. Ces valeurs reflètent une forte attraction nucléaire et contribuent à la stabilité chimique de la platine. Le rayon atomique s'étend à 1,39 Å sous forme métallique, tandis que le rayon covalent mesure 1,36 Å. L'affinité électronique démontre une valeur négative de −205,3 kJ/mol, indiquant une addition électronique défavorable. Les propriétés magnétiques nucléaires incluent six isotopes stables, avec ¹⁹⁵Pt possédant un spin nucléaire I = 1/2 et représentant 33,83 % d'abondance naturelle.
Caractéristiques physiques macroscopiques
La platine pure affiche une apparence brillante et blanche argentée avec des propriétés exceptionnelles de ductilité et malléabilité. Le métal cristallise dans une structure cubique à faces centrées (groupe spatial Fm3m) avec un paramètre de réseau a = 3,9231 Å à température ambiante. La fusion se produit à 2041,4 K (1768,3°C), tandis que l'ébullition atteint 4098 K (3825°C) sous pression atmosphérique standard. L'enthalpie de fusion mesure 22,175 kJ/mol, et l'enthalpie de vaporisation égale 469,9 kJ/mol. La capacité thermique spécifique démontre 25,86 J/(mol·K) à 298,15 K. La densité atteint 21,45 g/cm³ dans des conditions standard, plaçant la platine parmi les éléments naturels les plus denses. La conductivité thermique est de 71,6 W/(m·K), tandis que la conductivité électrique mesure 9,43 × 10⁶ S/m à 293 K.
Propriétés chimiques et réactivité
Structure électronique et comportement de liaison
La configuration d⁹ des électrons de la platine permet des géométries de coordination variées et des états d'oxydation allant de −2 à +10, bien que +2 et +4 prédominent dans les composés stables. Les orbitales d partiellement remplies facilitent des liaisons de coordination fortes avec divers ligands, particulièrement les atomes donneurs mous selon la théorie des acides et bases durs et mous de Pearson. La géométrie carrée plane caractérise les complexes Pt(II), résultant de l'effet de stabilisation du champ cristallin dans les systèmes d⁸. La formation des liaisons implique une participation significative des orbitales d, produisant des interactions Pt-ligand fortes avec des énergies de dissociation souvent supérieures à 300 kJ/mol. Les liaisons Pt-C démontrent une force particulière, mesurant environ 536 kJ/mol dans les complexes organométalliques. Le métal présente un effet trans prononcé, influençant les mécanismes de réaction de substitution et les schémas de stabilité des complexes.
Propriétés électrochimiques et thermodynamiques
Les valeurs d'électronégativité s'étendent à 2,28 sur l'échelle de Pauling et 2,25 sur l'échelle d'Allred-Rochow, indiquant une capacité modérée d'attraction électronique. Les potentiels de réduction standard démontrent une variation significative selon l'état d'oxydation : Pt²⁺/Pt présente E° = +1,118 V, tandis que PtCl₄²⁻/Pt mesure E° = +0,755 V. Le couple PtO₂/Pt affiche E° = +1,045 V dans des conditions standard. La position de la platine dans la série électrochimique établit son caractère noble et sa résistance à la dissolution oxydative. La stabilité thermodynamique se manifeste par des enthalpies de formation négatives pour la plupart des composés binaires, incluant ΔfH° = −80,3 kJ/mol pour PtO et ΔfH° = −123,4 kJ/mol pour PtO₂. Les énergies successives d'ionisation augmentent systématiquement : 870, 1791 et 2800 kJ/mol pour les première, seconde et troisième ionisations respectivement.
Composés chimiques et formation de complexes
Composés binaires et ternaires
La platine forme de nombreux composés binaires présentant des stœchiométries et arrangements structuraux variés. Les oxydes incluent PtO (structure de la tenorite) et PtO₂ (structure rutile), démontrant tous deux un comportement amphotère avec dissolution dans les acides et les bases fortes. Les composés d'halogénures couvrent la série complète de PtF₂ à PtI₄, le PtF₆ tétraédrique représentant l'état d'oxydation le plus élevé des fluorures. Les chloroplatines constituent des classes de composés particulièrement importantes, incluant l'acide hexachloroplatique H₂PtCl₆ et divers sels métalliques alcalins. Les sulfures comprennent PtS (structure de la cooperite) et PtS₂, couramment rencontrés dans les dépôts minéraux naturels. Les systèmes ternaires incorporent des compositions variées comme BaPtO₃ (structure perovskite) et K₂PtCl₄ (structure en couches), démontrant la versatilité de la platine dans les cadres complexes d'oxydes et d'halogénures.
Chimie de coordination et composés organométalliques
La platine démontre une chimie de coordination étendue avec des ligands allant d'ions simples à des molécules organiques complexes. Les nombres de coordination courants incluent 2, 4 et 6, la géométrie carrée plane prédominant pour les espèces Pt(II). Des exemples classiques incluent le sel de Zeise K[PtCl₃(C₂H₄)]·H₂O, représentant une découverte organométallique précoce. Les complexes de phosphines démontrent une stabilité exceptionnelle, exemplifiée par PtCl₂(PPh₃)₂ avec des longueurs de liaison Pt-P d'environ 2,31 Å. Les ligands donneurs d'azote forment des complexes stables, incluant la cisplatine cis-[PtCl₂(NH₃)₂] avec une activité anticancéreuse documentée. Les composés organométalliques de la platine comprennent des types structuraux variés, des complexes alkyles simples aux métallacycles élaborés. Les espèces catalytiquement actives impliquent fréquemment des ligands phosphinés ou azotés, facilitant l'activation des substrats par coordination puis transformation subséquente.
Occurrence naturelle et analyse isotopique
Distribution géochimique et abondance
La platine démontre une abondance crustale extrêmement faible d'environ 5 μg/kg (5 ppb), la classant parmi les éléments les plus rares de la Terre. Son comportement géochimique reflète son caractère sidérophile, avec une forte affinité pour les phases métalliques durant les processus de différenciation planétaire. Les dépôts primaires s'associent aux complexes ignés mafiques et ultramafiques, particulièrement les intrusions stratifiées comme le Complexe de Bushveld en Afrique du Sud et le Complexe de Stillwater au Montana. Le Merensky Reef dans le Bushveld contient environ 75 % des réserves mondiales de platine, concentrées par fractionnement magmatique. Les dépôts alluvionnaires résultent de l'altération et de l'érosion des sources primaires, historiquement importants en Colombie et dans les monts Uraux. Les statistiques modernes indiquent que l'Afrique du Sud produit environ 70 % de la production mondiale, suivie par la Russie à 15 % et l'Amérique du Nord à 10 %.
Propriétés nucléaires et composition isotopique
La platine naturelle comprend six isotopes stables : ¹⁹⁰Pt (0,012 %), ¹⁹²Pt (0,782 %), ¹⁹⁴Pt (32,967 %), ¹⁹⁵Pt (33,832 %), ¹⁹⁶Pt (25,242 %) et ¹⁹⁸Pt (7,163 %). L'isotope ¹⁹⁵Pt possède un spin nucléaire I = 1/2 avec un moment magnétique μ = 0,6095 magnéton nucléaire, permettant des applications en spectroscopie RMN. L'isotope ¹⁹⁰Pt subit une désintégration alpha avec une demi-vie de 4,83 × 10¹¹ années, produisant une activité de 16,8 Bq/kg dans les échantillons naturels. Les sections efficaces neutroniques varient considérablement entre isotopes, avec ¹⁹⁵Pt présentant une section d'absorption thermique de 27,5 barnes. Les isotopes synthétiques s'étendent de ¹⁶⁵Pt à ²⁰⁸Pt, avec ¹⁹³Pt démontrant la demi-vie la plus longue (50 ans) parmi les espèces radioactives. Les applications nucléaires utilisent des isotopes spécifiques pour la recherche et les usages médicaux, particulièrement dans les protocoles de radiothérapie.
Production industrielle et applications technologiques
Méthodologies d'extraction et purification
L'extraction primaire de la platine implique le minage de minerais sulfurés suivi de séquences complexes de traitement métallurgique. La concentration initiale utilise des techniques de flottation, enrichissant les métaux du groupe platine (PGMs) de teneurs typiques de 3-10 g/t à des concentrés contenant 100-300 g/t de PGMs. Les opérations de fusion à des températures supérieures à 1500°C produisent une matte contenant des alliages cuivre-nickel-PGM. La lixiviation sous pression et l'extraction par solvant suivantes séparent les métaux de base des éléments du groupe platine. La purification finale emploie la dissolution à l'eau régale suivie de précipitations et réductions sélectives. Les opérations à grande échelle atteignent des puretés supérieures à 99,95 % à travers plusieurs étapes de raffinage. La production mondiale annuelle approche 190 tonnes, l'efficacité de traitement récupérant généralement 85-95 % de la platine contenue dans les minerais. Les considérations environnementales nécessitent une gestion rigoureuse des produits chimiques et émissions gazeuses, particulièrement le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote.
Applications technologiques et perspectives futures
Les convertisseurs catalytiques automobiles consomment environ 45 % de la production annuelle de platine, exploitant ses capacités exceptionnelles de catalyse d'oxydation et de réduction. Les applications en raffinage pétrolier représentent 9 % de la consommation, principalement dans les processus de reformage catalytique convertissant le naphta en essence à haute teneur en octane. Les demandes en joaillerie représentent 34 %, profitant de la durabilité et résistance à l'oxydation de la platine. Les applications émergentes incluent les technologies de piles à combustible pour les systèmes énergétiques à hydrogène, où la platine catalyse les réactions de réduction de l'oxygène et d'oxydation de l'hydrogène avec une efficacité exceptionnelle. Les applications électroniques exploitent la stabilité chimique et la conductivité électrique de la platine dans les composants de disques durs et contacts spécialisés. Les usages médicaux comprennent des rôles catalytiques en synthèse pharmaceutique et des applications thérapeutiques directes dans des composés anticancéreux comme la cisplatine et la carboplatine. Les développements futurs se concentrent sur la réduction de la charge en platine dans les applications catalytiques tout en maintenant des normes de performance.
Développement historique et découverte
Des preuves archéologiques indiquent l'utilisation de la platine par des civilisations précolombiennes en Équateur et Colombie actuels, qui créèrent des artefacts en alliage or-platine par des techniques de métallurgie des poudres. La reconnaissance européenne débuta avec la description de Julius Caesar Scaliger en 1557 d'un métal noble inconnu de la région du Darién. Les colonisateurs espagnols considérèrent initialement la platine comme une impureté dans les dépôts d'or, entraînant des prohibitions officielles contre son usage dans des applications monétaires. L'étude scientifique commença avec les travaux systématiques d'Antonio de Ulloa après son expédition sud-américaine de 1735 à 1748, aboutissant à la première description détaillée en Europe publiée en 1748. La présentation de William Brownrigg à la Royal Society en 1750 établit l'identité chimique distincte de la platine. Les travaux de Pierre-François Chabaneau en Espagne dans les années 1780 parvinrent à purifier et travailler le métal platine malléable. Le nom de l'élément dérive du mot espagnol "platina", diminutif de "plata" signifiant argent, reflétant son apparence argentée. La compréhension moderne se développa grâce aux contributions de nombreux chimistes comme Scheffer, Bergman et Berzelius durant les XVIIIe et XIXe siècles.
Conclusion
La combinaison unique d'inertie chimique, d'activité catalytique et de durabilité physique établit la position irremplaçable de la platine dans la technologie et l'industrie modernes. Sa configuration électronique d⁹ permet une chimie de coordination variée tout en maintenant une stabilité exceptionnelle sous conditions extrêmes. Les applications industrielles continuent de s'étendre, particulièrement dans les technologies énergétiques émergentes et les systèmes de protection environnementale. Les recherches futures visent à maximiser l'efficacité catalytique tout en réduisant la consommation de platine, motivées par les contraintes d'approvisionnement et les considérations économiques. Les méthodes synthétiques avancées et les approches en nanotechnologie promettent des performances améliorées dans les piles à combustible, le contrôle de la pollution et les applications de synthèse chimique.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
