| Élément | |
|---|---|
42MoMolybdène95.9422
8 18 13 1 |
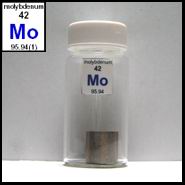
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 42 |
| Masse atomique | 95.942 amu |
| Famille d'éléments | Les métaux de transition |
| Période | 5 |
| Groupe | 1 |
| Bloc | s-block |
| Année découverte | 1778 |
| Distribution des isotopes |
|---|
92Mo 14.84% 94Mo 9.25% 95Mo 15.92% 96Mo 16.68% 97Mo 9.55% 98Mo 24.13% |
92Mo (16.42%) 94Mo (10.24%) 95Mo (17.62%) 96Mo (18.46%) 97Mo (10.57%) 98Mo (26.70%) |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 10.22 g/cm3 (STP) |
H (H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 2617 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 5560 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | +4, +6 (-4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +5) |
| Potentiel de première ionisation | 7.092 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | 0.747 eV |
Nobelium (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 2.16 |
Césium (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |
| Rayon atomique | |
|---|---|
| Rayon covalent | 1.38 Å |
H (H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |
| Rayon métallique | 1.39 Å |
Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |
| Composés | ||
|---|---|---|
| Formule | Nom | État d'oxydation |
| MoBr2 | Bromure de molybdène (II) | +2 |
| MoBr3 | Bromure de molybdène (III) | +3 |
| MoCl3 | Chlorure de molybdène (III) | +3 |
| MoI3 | Iodure de molybdène (III) | +3 |
| MoS2 | Disulfure de molybdène | +4 |
| MoBr4 | Bromure de molybdène (IV) | +4 |
| MoF4 | Fluorure de molybdène (IV) | +4 |
| MoO2 | Oxyde de molybdène (IV) | +4 |
| MoF5 | Fluorure de molybdène (V) | +5 |
| MoO3 | Trioxyde de molybdène | +6 |
| Na2MoO4 | Molybdate de sodium | +6 |
| (NH4)6Mo7O24 | Heptamolybdate d'ammonium | +6 |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 18, 13, 1 |
| Configuration électronique | [Kr] 4d5 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 6 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Molybdène (Mo) : Élément du Tableau Périodique
Résumé
Le molybdène (symbole Mo, numéro atomique 42) est un métal de transition de la sixième période du tableau périodique possédant une importance industrielle exceptionnelle. Ce métal gris-argenté possède le sixième point de fusion le plus élevé parmi les éléments naturels (2623°C) et démontre une remarquable stabilité thermique grâce à l'un des coefficients de dilatation thermique les plus faibles parmi les métaux commerciaux. Le molybdène présente divers états d'oxydation allant de −4 à +6, les états +4 et +6 étant les plus courants dans les composés terrestres. L'élément se trouve principalement sous forme de molybdénite (MoS2) et est utilisé dans les alliages d'acier à haute résistance, représentant environ 80% de la production mondiale. Au-delà des applications métallurgiques, le molybdène joue un rôle essentiel en tant que cofacteur dans de nombreux systèmes enzymatiques biologiques, notamment dans les processus de fixation de l'azote catalysés par la nitrogenase.
Introduction
Le molybdène occupe une position unique dans la deuxième série des métaux de transition, entre le niobium et le technétium dans le tableau périodique. Le nom de l'élément provient du mot grec ancien μόλυβδος (molybdos), signifiant "plomb", en référence à la confusion historique entre la molybdénite et les minerais de galène. Carl Wilhelm Scheele a caractérisé définitivement le molybdène en 1778, tandis que Peter Jacob Hjelm a réussi à isoler le métal en 1781 par réduction au carbone et à l'huile de lin.
La configuration électronique [Kr]4d55s1 place le molybdène dans le groupe du chrome, lui conférant une versatilité chimique similaire en termes d'états d'oxydation accessibles. Cette configuration explique ses capacités exceptionnelles de liaison, notamment la formation de liaisons multiples entre atomes métalliques et de composés en clusters stables. Son importance industrielle s'est affirmée au XXe siècle, en particulier grâce aux avancées métallurgiques permettant le traitement à grande échelle des minerais de molybdénite.
Propriétés physiques et structure atomique
Paramètres atomiques fondamentaux
Le molybdène possède un numéro atomique de 42 et une masse atomique standard de 95,95 ± 0,01 g/mol. Sa configuration électronique [Kr]4d55s1 reflète le motif d5s1 caractéristique de la famille du chrome. Cette configuration donne une première énergie d'ionisation de 684,3 kJ/mol, nettement inférieure à celle du chrome (652,9 kJ/mol), en raison de l'augmentation du rayon atomique et des effets renforcés de blindage électronique.
Le rayon atomique mesure 139 pm en coordination métallique, tandis que les rayons ioniques varient fortement selon l'état d'oxydation et l'environnement de coordination. L'ion Mo6+ présente un rayon de 59 pm en coordination octaédrique, alors que le Mo4+ mesure 65 pm dans des conditions similaires. Les calculs de charge nucléaire effective indiquent un blindage substantiel des électrons externes par la sous-couche 4p remplie, expliquant les énergies d'ionisation relativement modérées malgré la charge nucléaire élevée.
Caractéristiques physiques macroscopiques
Le molybdène cristallise dans une structure cubique centrée avec un paramètre de réseau a = 314,7 pm à température ambiante. Le métal présente une stabilité thermique exceptionnelle avec un point de fusion de 2623°C, le plaçant sixième parmi les éléments naturels après le carbone, le tungstène, le rhénium, l'osmium et le tantale. Son point d'ébullition atteint environ 4639°C sous pression atmosphérique standard.
La densité est de 10,22 g/cm3 à 20°C, reflétant la structure métallique compacte et la masse atomique élevée. Le coefficient de dilatation thermique linéaire est de 4,8 × 10−6 K−1 entre 0°C et 100°C, l'un des plus faibles parmi les métaux commerciaux. Cette propriété est cruciale pour les applications à haute température où la stabilité dimensionnelle est essentielle. La capacité thermique spécifique est de 0,251 J/g·K à 25°C, tandis que la conductivité thermique atteint 142 W/m·K à température ambiante.
Propriétés chimiques et réactivité
Structure électronique et comportement de liaison
La configuration électronique d5s1 permet au molybdène d'adopter des états d'oxydation allant de −4 à +6, les états intermédiaires +4 et +6 étant particulièrement stables. Les orbitales d partiellement remplies favorisent des interactions π étendues avec des ligands appropriés, notamment ceux contenant des atomes donneurs d'oxygène, de soufre ou d'azote.
Le molybdène gazeux existe principalement sous forme de dimère Mo2, caractérisé par une liaison sextuple extrêmement forte. Cette liaison implique une liaison σ, deux liaisons π et deux liaisons δ, ainsi qu'une paire d'électrons supplémentaire dans une orbitale liante, donnant un ordre de liaison de six. La distance de liaison Mo-Mo est de 194 pm avec une énergie de dissociation supérieure à 400 kJ/mol.
Dans les composés solides, le molybdène forme facilement des clusters métalliques, particulièrement en états d'oxydation intermédiaires. Les clusters octaédriques Mo6 en sont des exemples archétypaux, stabilisés par des liaisons métalliques étendues au sein du cœur du cluster. Ces structures présentent une stabilité cinétique remarquable et servent de blocs de construction pour des structures à l'état solide plus complexes.
Propriétés électrochimiques et thermodynamiques
L'électronégativité sur l'échelle de Pauling est de 2,16, positionnant le molybdène entre le chrome (1,66) et le tungstène (2,36). Cette électronégativité modérée reflète l'équilibre entre caractères métalliques et non métalliques typique des éléments de transition de la deuxième ligne.
Les énergies d'ionisation successives montrent la difficulté croissante d'extraction des électrons à partir d'états d'oxydation plus élevés. Les première à quatrième énergies d'ionisation valent respectivement 684,3, 1560, 2618 et 4480 kJ/mol. L'augmentation considérable entre la quatrième et la cinquième énergie d'ionisation (7230 kJ/mol) marque la pénétration dans les orbitales 4d plus étroitement liées.
Les potentiels de réduction standard varient fortement selon les conditions de la solution et l'environnement des ligands. Le couple Mo6+/Mo3+ présente un E° = +0,43 V en milieu acide, tandis que le couple MoO42−/Mo affiche un E° = −0,913 V en conditions alcalines standard. Ces valeurs indiquent un caractère oxydant modéré pour les états d'oxydation élevés et des propriétés réductrices fortes pour l'élément métallique.
Composés chimiques et formation de complexes
Composés binaires et ternaires
Le trioxyde de molybdène (MoO3) est le composé binaire le plus stable thermodynamiquement, possédant une structure en couches avec une coordination octaédrique MoO6 déformée. Ce solide jaune pâle sublime à 795°C et constitue le précurseur principal de presque tous les composés de molybdène. Il présente des propriétés acides faibles, se dissolvant dans les solutions alcalines fortes pour former des anions molybdates.
Le disulfure de molybdène (MoS2) est le minéral principal naturel, adoptant une structure en couches hexagonales comparable à celle du graphite. Les interactions faibles de type van der Waals entre les couches de sulfures confèrent des propriétés lubrifiantes exceptionnelles, rendant MoS2 précieux pour les applications à haute température et pression où les lubrifiants organiques se dégradent.
Les composés halogénés couvrent l'ensemble des états d'oxydation accessibles, de MoCl2 à MoF6. L'hexafluorure de molybdène est le plus haut halogénure binaire, extrêmement réactif vis-à-vis de l'humidité et des composés organiques. L'hexachlorure MoCl6 est instable à température ambiante, se décomposant spontanément en MoCl5 et gaz de chlore.
Chimie de coordination et composés organométalliques
Le molybdène démontre une versatilité remarquable en chimie de coordination, formant des complexes stables dans divers états d'oxydation avec des ensembles de ligands variés. La coordination octaédrique domine pour les états Mo(VI) et Mo(IV), tandis que les états inférieurs adoptent souvent des géométries déformées dues aux interactions de liaison métal-métal.
Le hexacarbonyle Mo(CO)6 illustre parfaitement la chimie du molybdène à valence zéro, possédant une géométrie octaédrique avec un fort rétrodon de π entre les orbitales d du métal et les orbitales π* du CO. Ce composé sert de précurseur polyvalent pour de nombreux dérivés organomolybdéniques par réactions de substitution de ligands.
La chimie des polyoxomolybdates englobe une vaste famille d'anions discrets ou polymériques formés par condensation d'unités molybdates. L'anion hétéropolymolybdate P[Mo12O40]3− de structure Keggin est un exemple archétypal, intégrant un tétraèdre phosphate central entouré de douze octaèdres MoO6 partageant des arêtes. Ces composés trouvent des applications en catalyse et en chimie analytique.
Présence naturelle et analyse isotopique
Distribution géochimique et abondance
Le molybdène est le 54e élément le plus abondant dans la croûte terrestre avec une concentration moyenne de 1,5 ppm en masse. Cette abondance le classe parmi les éléments modérément rares, bien moins courant que le fer (56 300 ppm) ou le chrome (122 ppm), mais plus abondant que l'argent (0,075 ppm) ou l'or (0,004 ppm).
En environnement oxydant, le molybdène présente un caractère lithophile avec prédominance des espèces Mo(VI). Dans des conditions réductrices typiques de certains environnements sédimentaires, il se concentre dans les minerais sulfurés en précipitant sous forme de MoS2. L'eau de mer contient environ 10 ppb de molybdène, principalement sous forme d'anion molybdate MoO42−.
Les principaux gisements de molybdène se trouvent dans des systèmes porphyriques associés à des intrusions granitiques, où les fluides hydrothermaux transportent le molybdène sous forme de divers complexes. Les mécanismes de concentration secondaires incluent l'altération et les processus de transport pouvant enrichir certains environnements géologiques en molybdène.
Propriétés nucléaires et composition isotopique
Sept isotopes naturels constituent la distribution isotopique du molybdène : 92Mo (14,84%), 94Mo (9,25%), 95Mo (15,92%), 96Mo (16,68%), 97Mo (9,55%), 98Mo (24,13%) et 100Mo (9,63%). L'isotope le plus abondant, 98Mo, est entièrement stable, tandis que 100Mo subit une désintégration bêta double avec une demi-vie extraordinairement longue d'environ 1019 années.
Les radioisotopes synthétiques s'étendent de 81Mo à 119Mo, avec 93Mo comme isotope artificiel le plus stable (t1/2 = 4 839 ans). Les applications médicales utilisent 99Mo (t1/2 = 66,0 heures), produit par activation neutronique ou fission, qui se désintègre en technétium-99m pour les examens d'imagerie diagnostique.
Les sections efficaces nucléaires varient fortement selon les isotopes, 98Mo présentant une section efficace d'absorption des neutrons thermiques de 0,13 barns. Ces propriétés nucléaires influencent les applications en réacteur et les stratégies de production isotopique pour la recherche et la médecine.
Production industrielle et applications technologiques
Méthodologies d'extraction et de purification
La production primaire de molybdène commence par la concentration par flottation de la molybdénite (MoS2), exploitant ses propriétés hydrophobes naturelles. La flottation par moussage permet un facteur de concentration supérieur à 1000:1, produisant des concentrés contenant 85-92% de MoS2.
La torréfaction des concentrés de molybdénite à 700°C dans l'air convertit le sulfure en trioxyde de molybdène selon la réaction : 2MoS2 + 7O2 → 2MoO3 + 4SO2. La récupération du dioxyde de soufre pour la production d'acide sulfurique est une considération économique essentielle dans les opérations à grande échelle.
Le traitement suivant implique une lixiviation ammoniacale pour former du molybdate d'ammonium soluble [(NH4)2MoO4], puis une précipitation en dimolybdate d'ammonium. La décomposition thermique de cet intermédiaire à 500°C donne un trioxyde de molybdène de haute pureté. La production métallique s'effectue ensuite par réduction à l'hydrogène à 1000°C, générant une poudre de molybdène avec une pureté supérieure à 99,95%.
Applications technologiques et perspectives futures
Les applications dans l'industrie sidérurgique consomment environ 80% de la production mondiale de molybdène, où cet élément agit comme agent de renforcement puissant dans les aciers alliés. Des additions de 0,15-0,30% de molybdène améliorent significativement la trempabilité, la résistance au fluage et à la corrosion dans les aciers inoxydables. Les aciers rapides pour outils contiennent généralement 5-10% de molybdène pour conserver leur dureté à haute température.
Les superalliages exploitent la résistance exceptionnelle du molybdène à haute température et sa résistance à l'oxydation. Les superalliages à base de nickel pour composants de turbines à gaz incorporent 3-6% de molybdène pour maintenir leurs propriétés mécaniques au-delà de 1000°C. Les alliages molybdène-rhénium démontrent une ductilité supérieure pour les applications spatiales nécessitant des cycles extrêmes de température.
Les technologies émergentes incluent les lubrifiants à base de disulfure de molybdène pour l'aérospatiale, les cibles en molybdène pour les procédés de pulvérisation cathodique dans la fabrication des semiconducteurs, et les électrodes en molybdène pour la fusion du verre. Les conceptions avancées de réacteurs nucléaires prévoient l'utilisation d'alliages molybdène-technétium pour des composants structurels grâce à leurs excellentes propriétés de résistance au rayonnement.
Développement historique et découverte
La reconnaissance historique de la molybdénite a précédé sa compréhension chimique de plusieurs millénaires, les civilisations anciennes l'utilisant comme matériau d'écriture similaire au graphite. Les premières études chimiques systématiques ont débuté en 1754 lorsque Bengt Andersson Qvist a démontré que la molybdénite ne contenait pas de plomb, contrairement aux hypothèses dominantes basées sur sa ressemblance avec la galène.
La caractérisation définitive de Carl Wilhelm Scheele en 1778 a établi la molybdénite comme minerai d'un élément inconnu jusqu'alors, qu'il proposa de nommer molybdène. Peter Jacob Hjelm a obtenu le premier isolat métallique en 1781 par réduction du carbone sur l'acide molybdique, bien que le produit résultant contînt des impuretés significatives dues aux techniques de purification primitives.
Le développement industriel est resté limité jusqu'au XXe siècle en raison des difficultés de traitement et de l'absence d'applications claires. Le brevet de William D. Coolidge en 1906, rendant le molybdène ductile, a permis son utilisation pratique dans des environnements à haute température. Le procédé de flottation par moussage développé par Frank E. Elmore en 1913 a établi les fondations des méthodes modernes d'extraction du molybdène.
Les besoins stratégiques de la Première Guerre mondiale ont accéléré le développement du molybdène pour les applications en acier blindé, tandis que la demande durant la Seconde Guerre mondiale a consolidé sa position comme matériau stratégique critique. L'expansion post-guerre vers des applications civiles, notamment dans la production d'acier inoxydable et le traitement chimique, a établi l'industrie moderne du molybdène.
Conclusion
Le molybdène démontre une polyvalence exceptionnelle à la fois en tant que métal structural et en tant qu'élément chimique, reliant la chimie fondamentale et les applications technologiques avancées. Sa structure électronique unique permet une chimie variée en fonction des états d'oxydation tout en maintenant stabilité thermique et mécanique sous des conditions extrêmes. Son rôle double en métallurgie industrielle et dans les systèmes enzymatiques biologiques souligne son importance fondamentale à travers plusieurs disciplines.
Les recherches futures porteront sur le développement d'alliages avancés pour les applications aérospatiales de nouvelle génération, l'exploration de catalyseurs à base de molybdène pour des procédés chimiques durables, et l'étude de la chimie biologique du molybdène pour des applications thérapeutiques potentielles. L'expansion continue des technologies à haute température et des systèmes d'énergie renouvelable garantit la persistance de la pertinence du molybdène en science des matériaux et en ingénierie chimique.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
