| Élément | |
|---|---|
13AlAluminium26.981538682
8 3 |
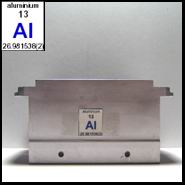
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 13 |
| Masse atomique | 26.98153868 amu |
| Famille d'éléments | D'autres métaux |
| Période | 3 |
| Groupe | 13 |
| Bloc | p-block |
| Année découverte | 1824 |
| Distribution des isotopes |
|---|
27Al 100% |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 2.698 g/cm3 (STP) |
H (H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 660.25 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 2467 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | +3 (-2, -1, 0, +1, +2) |
| Potentiel de première ionisation | 5.985 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | 0.433 eV |
Nobelium (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 1.61 |
Césium (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |
| Rayon atomique | |
|---|---|
| Rayon covalent | 1.26 Å |
H (H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |
| Van der Waals rayon | 1.84 Å |
H (H) 1.2 Francium (Fr) 3.48 | |
| Rayon métallique | 1.43 Å |
Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |
| Composés | ||
|---|---|---|
| Formule | Nom | État d'oxydation |
| Al2O | Oxyde d'aluminium(I) | +1 |
| AlBr | Monobromure d'aluminium | +1 |
| AlCl | Monochlorure d'aluminium | +1 |
| AlF | Monofluorure d'aluminium | +1 |
| AlI | Monoiodure d'aluminium | +1 |
| AlB12 | Dodécaboride d'aluminium | +2 |
| AlB2 | Diborure d'aluminium | +2 |
| AlO | Oxyde d'aluminium(II) | +2 |
| Al2(SO4)3 | Sulfate d'aluminium | +3 |
| Al2O3 | Oxyde d'aluminium | +3 |
| AlCl3 | Chlorure d'aluminium | +3 |
| Al(OH)3 | Hydroxyde d'aluminium | +3 |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 3 |
| Configuration électronique | [Ne] 3s2 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 3 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Aluminium (Al) : Élément du Tableau Périodique
Résumé
L'aluminium (numéro atomique 13, symbole Al) représente un métal post-transitionnel fondamental dans le groupe du bore du tableau périodique. Avec une configuration électronique de [Ne] 3s² 3p¹, l'aluminium présente des propriétés caractéristiques incluant une faible densité (2,70 g/cm³), une haute réactivité vis-à-vis de l'oxygène et une excellente conductivité thermique et électrique. L'élément démontre un état d'oxydation prédominant +3, formant des composés avec un caractère covalent significatif dû à son rapport charge/taille élevé. L'abondance crustale de l'aluminium (8,23%) en fait le troisième élément le plus abondant dans la croûte terrestre, se trouvant principalement dans les minerais de bauxite. L'extraction industrielle par le procédé Hall-Héroult permet des applications technologiques étendues allant des alliages aérospatiaux aux composants électroniques. La combinaison unique de faible densité, résistance à la corrosion par passivation oxydante et propriétés mécaniques établit son rôle critique dans les sciences et l'ingénierie des matériaux modernes.
Introduction
L'aluminium occupe la position 13 dans le tableau périodique, située dans la période 3 et le groupe 13 (IIIA), communément désigné comme le groupe du bore. Sa structure électronique, caractérisée par trois électrons de valence au-delà d'une configuration de cœur néon stable, détermine fondamentalement son comportement chimique et ses propriétés physiques. Sa découverte en 1825 par Hans Christian Ørsted a marqué le début de recherches étendues en chimie des métaux post-transitionnels, culminant avec le développement de procédés industriels d'extraction transformant la science des matériaux à l'échelle mondiale.
L'importance de l'aluminium dépasse ses propriétés chimiques fondamentales pour englober des applications technologiques critiques dans les industries aérospatiale, de la construction et de l'électronique. Son profil de propriétés unique, combinant faible densité et résistance mécanique substantielle lorsqu'allié, en fait un matériau essentiel pour les applications sensibles au poids. Son affinité élevée pour l'oxygène entraîne la formation spontanée de couches protectrices d'oxyde, conférant une résistance exceptionnelle à la corrosion qui améliore sa durabilité dans les applications environnementales.
Les tendances périodiques du groupe 13 démontrent la position intermédiaire de l'aluminium entre le caractère covalent du bore et le comportement de plus en plus métallique observé dans le gallium, l'indium et le thallium. Cette position se manifeste par sa nature amphotère, lui permettant de former à la fois des espèces cationiques et anioniques selon l'environnement chimique et les conditions de réaction.
Propriétés Physiques et Structure Atomique
Paramètres Atomiques Fondamentaux
La structure atomique de l'aluminium comprend 13 protons, 14 neutrons dans son isotope le plus abondant ²⁷Al, et 13 électrons organisés dans la configuration [Ne] 3s² 3p¹. Le rayon atomique mesure 143 pm pour l'atome neutre, tandis que le rayon ionique de Al³⁺ se contracte significativement à 53,5 pm en coordination octaédrique et 39 pm en coordination tétraédrique, reflétant le rapport charge/taille élevé caractéristique des ions aluminium.
Les trois premières énergies d'ionisation de l'aluminium sont respectivement de 577,5 kJ/mol, 1816,7 kJ/mol et 2744,8 kJ/mol, tandis que la quatrième énergie d'ionisation augmente brusquement à 11 577 kJ/mol en raison de la perturbation de la configuration électronique stable de type néon. Ce schéma d'ionisation explique la tendance de l'aluminium à former des ions Al³⁺ plutôt que des états d'oxydation supérieurs dans des conditions normales.
Les valeurs d'électronégativité de l'aluminium sont de 1,61 sur l'échelle de Pauling et de 1,47 sur l'échelle d'Allred-Rochow, le plaçant entre les régimes de liaison ionique et covalente. La charge nucléaire effective ressentie par les électrons de valence est d'environ 2,99, tenant compte des effets d'écran des électrons internes et contribuant à son électronégativité modérée comparée à celle des éléments voisins.
Caractéristiques Physiques Macroscopiques
L'aluminium présente un lustre métallique argenté-blanc caractéristique avec des propriétés exceptionnelles de réflexion de la lumière dans les régions ultraviolettes, visibles et infrarouges. Il cristallise dans une structure cubique à faces centrées (cfc) avec un paramètre de réseau a = 4,0495 Å à température ambiante. Cette structure cristalline, partagée avec le cuivre et le plomb, maximise l'efficacité d'empilement et contribue aux propriétés mécaniques de l'aluminium.
Ses propriétés thermodynamiques incluent un point de fusion de 660,3°C, un point d'ébullition de 2519°C, une chaleur de fusion de 10,71 kJ/mol et une chaleur de vaporisation de 294,0 kJ/mol. La capacité thermique spécifique mesure 0,897 J/(g·K) à 25°C, tandis que la conductivité thermique atteint 237 W/(m·K), parmi les plus élevées pour les éléments métalliques. La conductivité électrique est de 37,7 × 10⁶ S/m, environ 61% de celle du cuivre tout en ne conservant que 30% de sa densité.
Les mesures de densité donnent 2,70 g/cm³ dans des conditions standard, nettement inférieure à celle de la plupart des métaux structurels comme le fer (7,87 g/cm³) et le cuivre (8,96 g/cm³). Cette faible densité résulte de sa masse atomique relativement légère (26,98 u) combinée à un empilement cristallin efficace, le rendant avantageux pour les applications exigeant un rapport résistance/poids élevé.
Propriétés Chimiques et Réactivité
Structure Électronique et Comportement de Liaison
La réactivité chimique de l'aluminium découle de sa configuration électronique [Ne] 3s² 3p¹, avec trois électrons de valence facilement disponibles pour la formation de liaisons. L'élément montre une forte tendance à adopter l'état d'oxydation +3 par perte de tous ses électrons de valence, bien que des états inférieurs (+1, +2) existent dans des conditions spéciales comme les réactions en phase gazeuse à haute température et les complexes organométalliques.
La formation de liaisons dans les composés d'aluminium présente un caractère covalent significatif malgré les distributions de charge ionique formelles. La haute densité de charge de l'ion Al³⁺ induit la polarisation des nuages électroniques des atomes voisins, conduisant à des liaisons partiellement covalentes selon les règles de Fajans. Ce caractère covalent se manifeste dans la volatilité des halogénures d'aluminium et les schémas de solubilité de ses composés.
La chimie de coordination implique généralement des géométries tétraédriques ou octaédriques, avec des nombres de coordination variant de 4 à 6 dans la plupart des composés. La préférence de l'aluminium pour les hybridations sp³ et sp³d² permet la formation de structures complexes incluant les ions aluminate [Al(OH)₄]⁻ et les complexes octaédriques [AlF₆]³⁻. L'absence d'orbitales d disponibles dans la couche de valence limite les nombres de coordination comparés aux métaux de transition.
Propriétés Électrochimiques et Thermodynamiques
Le potentiel de réduction standard du couple Al³⁺/Al est de -1,66 V par rapport à l'électrode standard à hydrogène, indiquant un caractère réducteur fort en solution aqueuse. Ce potentiel négatif explique la position de l'aluminium dans la série électrochimique et sa tendance thermodynamique à subir des réactions d'oxydation, particulièrement avec l'eau et l'oxygène atmosphérique.
Les énergies successives d'ionisation démontrent la stabilité de l'état d'oxydation +3 : I₁ = 577,5 kJ/mol, I₂ = 1816,7 kJ/mol, I₃ = 2744,8 kJ/mol, avec une augmentation dramatique à I₄ = 11 577 kJ/mol. L'affinité électronique mesure -42,5 kJ/mol, indiquant une formation défavorable des anions Al⁻ et expliquant le comportement exclusivement cationique de l'aluminium dans les composés ioniques.
La stabilité thermodynamique de l'oxyde d'aluminium (Al₂O₃) est exceptionnelle avec une enthalpie standard de formation ΔH°f = -1675,7 kJ/mol. Cette stabilité considérable alimente la réactivité de l'aluminium vis-à-vis de l'oxygène et sous-tend le phénomène de passivation protectrice observé lors de l'exposition atmosphérique. L'énergie libre de Gibbs de formation pour Al₂O₃ est de -1582,3 kJ/mol, confirmant sa favorabilité thermodynamique dans des conditions standard.
Composés Chimiques et Formation de Complexes
Composés Binaires et Ternaires
L'oxyde d'aluminium (Al₂O₃) représente le composé binaire le plus important, existant sous plusieurs formes polymorphiques incluant l'alumine α (corindon), γ-alumine et δ-alumine. La forme α présente une structure cristalline hexagonale avec une dureté exceptionnelle (9 sur l'échelle de Mohs) et une inertie chimique, tandis que la γ-alumine montre une grande surface spécifique et une activité catalytique. La formation se produit par oxydation directe ou décomposition thermique des hydroxydes, la force motrice thermodynamique étant fournie par l'enthalpie de formation très négative.
Les halogénures d'aluminium démontrent des propriétés variables selon l'halogène. AlF₃ présente un caractère ionique avec un point de fusion élevé (1291°C) et une volatilité faible, tandis que AlCl₃, AlBr₃ et AlI₃ affichent un caractère moléculaire avec des structures dimériques en phase solide et vapeur. Les dimères Al₂Cl₆ possèdent des atomes de chlore pontants formant des centres d'aluminium tétracoordonnés, illustrant le caractère déficient en électrons typique des éléments du groupe du bore.
Le sulfure d'aluminium (Al₂S₃) cristallise dans une structure hexagonale et s'hydrolyse facilement dans l'air humide pour produire Al₂O₃ et sulfure d'hydrogène. Le nitrure d'aluminium (AlN) présente une structure wurtzite avec un caractère covalent important, démontrant une conductivité thermique excellente et des propriétés d'isolation électrique précieuses pour les applications en semi-conducteurs. Le carbure Al₄C₃ se forme par réaction directe à température élevée, produisant du méthane lors de l'hydrolyse selon la réaction : Al₄C₃ + 12H₂O → 4Al(OH)₃ + 3CH₄.
Chimie de Coordination et Composés Organométalliques
Les complexes d'aluminium adoptent généralement des géométries tétraédriques ou octaédriques dictées par les exigences stériques des ligands et les facteurs électroniques. Les nombres de coordination courants incluent 4, 5 et 6, avec des exemples comme [AlCl₄]⁻, [AlF₆]³⁻ et [Al(H₂O)₆]³⁺. La densité de charge élevée de Al³⁺ entraîne des interactions électrostatiques fortes avec les ligands et une activation significative de ceux-ci.
En chimie aqueuse, l'ion hexaaquaaluminium [Al(H₂O)₆]³⁺ subit des réactions d'hydrolyse produisant [Al(H₂O)₅OH]²⁺ et des espèces hydroxylées supérieures. Une déprotonation progressive conduit à la formation d'espèces polynucléaires et finalement à la précipitation d'Al(OH)₃ amorphe. La spéciation dépendante du pH démontre le comportement amphotère de l'aluminium, formant des ions aluminate solubles [Al(OH)₄]⁻ dans des conditions fortement alcalines.
La chimie organométallique englobe des dérivés alkyles et aryles, nécessitant généralement une stabilisation par coordination de bases de Lewis en raison du déficit électronique des centres d'aluminium. Le triméthylaluminium (Al(CH₃)₃) existe sous forme de dimère en phase condensée, avec des groupes méthyle pontants similaires aux structures des halogénures d'aluminium. Ses applications industrielles incluent la catalyse en polymérisation Ziegler-Natta et les procédés de dépôt chimique en phase vapeur pour la fabrication de semi-conducteurs.
Occurrence Naturelle et Analyse Isotopique
Distribution Géochimique et Abondance
L'aluminium est le troisième élément le plus abondant dans la croûte terrestre avec une concentration d'environ 8,23% en masse, soit 82 300 ppm. Cette abondance dépasse celle de tous les métaux sauf le silicium et l'oxygène, en faisant le métal le plus répandant dans les roches crustales. Sa distribution se concentre principalement dans les minéraux alumino-silicatés incluant les feldspaths, les micas et les minéraux argileux, reflétant son affinité forte pour l'oxygène et le silicium dans les environnements géologiques.
La bauxite constitue la source économique principale de l'aluminium, comprenant des oxydes d'aluminium hydratés comme la gibbsite (Al(OH)₃), la boehmite (AlO(OH)) et la diaspore (AlO(OH)). Les principaux gisements de bauxite se trouvent dans les régions tropicales et subtropicales où des processus d'altération intense concentrent l'aluminium par lessivage des éléments plus solubles. L'Australie, la Guinée et le Brésil possèdent les réserves les plus importantes, représentant environ 60% des ressources mondiales de bauxite.
Le comportement géochimique reflète la force du champ élevée et son caractère lithophile, entraînant son incorporation préférentielle dans les minéraux silicatés durant les processus magmatiques. L'altération libère l'aluminium des minéraux primaires, avec un transport et une dépôt subséquents contrôlés par le pH et la complexation organique. Son temps de résidence dans les sols s'étend souvent à plusieurs milliers d'années en raison de sa solubilité faible dans des conditions environnementales normales.
Propriétés Nucléaires et Composition Isotopique
L'aluminium est mononucléique avec ²⁷Al comme seul isotope stable, possédant une masse atomique de 26,9815385 u. Son spin nucléaire est de 5/2 avec un moment magnétique de +3,6415 magnétons nucléaires, permettant des applications en résonance magnétique nucléaire où son abondance naturelle de 100% fournit une sensibilité exceptionnelle pour les techniques analytiques.
Les isotopes radioactifs couvrent des nombres de masse de 21 à 43, avec ²⁶Al comme nucléide radioactif le plus stable (demi-vie 7,17 × 10⁵ ans). ²⁶Al subit une désintégration β⁺ vers ²⁶Mg et sert de radionucléide cosmogénique produit par la spallation des rayons cosmiques sur l'argon atmosphérique. Les rapports de ²⁶Al à ¹⁰Be fournissent des marqueurs chronologiques pour les processus géologiques sur des échelles de 10⁵ à 10⁶ ans.
Les sections efficaces nucléaires pour la capture neutronique thermique mesurent 0,231 barns pour ²⁷Al, produisant ²⁸Al à vie courte (demi-vie 2,24 minutes) par réactions (n,γ). Les propriétés nucléaires incluant l'énergie de liaison par nucléon (8,3 MeV) reflètent la stabilité du noyau ²⁷Al dans le cadre du modèle en couches nucléaires.
Production Industrielle et Applications Technologiques
Méthodes d'Extraction et de Purification
La production industrielle d'aluminium repose sur le procédé électrolytique Hall-Héroult, impliquant la dissolution d'alumine purifiée (Al₂O₃) dans du cryolithe fondu (Na₃AlF₆) à environ 960°C. L'électrolyse se produit entre des anodes et cathodes en carbone, avec la réaction globale : 2Al₂O₃ + 3C → 4Al + 3CO₂. Les densités de courant varient généralement entre 0,7 et 1,0 A/cm², nécessitant environ 13-15 kWh d'énergie électrique par kilogramme d'aluminium produit.
La préparation de l'alumine implique le procédé Bayer, où la bauxite est digérée dans une solution concentrée d'hydroxyde de sodium à 150-240°C, dissolvant les minerais alumineux tout en laissant les oxydes de fer et les silicates comme résidus insolubles. La précipitation d'hydroxyde d'aluminium pur se produit par refroidissement contrôlé et ensemencement, suivie de calcination à 1000-1200°C pour produire de l'alumine de qualité métallurgique.
La capacité mondiale de production dépasse 65 millions de tonnes métriques annuellement, la Chine dominante avec environ 57% de la production mondiale. Les exigences énergétiques constituent le facteur économique principal, les usines d'électrolyse étant généralement situées près de sources hydroélectriques abondantes. Le recyclage contribue significativement à l'approvisionnement, nécessitant seulement 5% de l'énergie requise pour la production primaire tout en préservant la qualité du matériau par fusion.
Applications Technologiques et Perspectives Futures
Les applications aérospatiales exploitent le rapport résistance/poids favorable de l'aluminium à travers des systèmes d'alliages avancés incluant les séries 2xxx (Al-Cu), 6xxx (Al-Mg-Si) et 7xxx (Al-Zn-Mg). Les mécanismes de durcissement par précipitation permettent d'atteindre des résistances d'élasticité supérieures à 500 MPa tout en maintenant des densités inférieures à 3,0 g/cm³. Les structures d'avion utilisent environ 80% d'alliages d'aluminium en poids, avec des applications allant des panneaux de fuselage aux composants moteur.
La consommation dans le secteur des transports englobe les panneaux de carrosserie automobile, les blocs moteur et les roues, motivée par les réglementations sur l'efficacité énergétique et les émissions. Les traitements thermiques incluant le recuit de solubilisation, la trempe et le vieillissement artificiel optimisent les propriétés mécaniques pour des applications spécifiques. Des techniques de mise en forme avancées comme le formage superplastique permettent des géométries complexes tout en maintenant l'intégrité structurelle.
Les applications électroniques exploitent la conductivité électrique de l'aluminium dans les lignes de transmission électrique, les dissipateurs thermiques et la métallisation des circuits intégrés. Le dépôt de films minces par pulvérisation ou évaporation crée des chemins conducteurs dans les dispositifs semi-conducteurs, les alliages aluminium-silicium prévenant les phénomènes de pointe aux jonctions. La résistance à la corrosion dans les environnements marins soutient les applications sur les plateformes offshore et les navires militaires par une sélection appropriée des alliages et traitements de surface.
Les technologies émergentes incluent la fabrication additive utilisant des poudres d'aluminium, permettant des géométries complexes impossibles à usiner conventionnellement. La recherche se concentre sur les alliages nanostructurés, les matériaux à gradient fonctionnel et les composites hybrides incorporant des renforts céramiques. Les applications de stockage d'hydrogène exploitquent la réaction de l'aluminium avec l'eau pour générer du gaz hydrogène, pouvant soutenir les systèmes futurs de stockage d'énergie.
Développement Historique et Découverte
La chronologie de la découverte de l'aluminium illustre l'évolution des connaissances chimiques et des capacités industrielles au XIXe siècle. Hans Christian Ørsted a isolé le premier l'aluminium métallique en 1825 par réduction du chlorure d'aluminium avec un amalgame de potassium, produisant de petites quantités de métal impur. Friedrich Wöhler a perfectionné le procédé en 1827, obtenant de l'aluminium pur par réduction avec du potassium métallique et établissant ses propriétés de base incluant sa densité et son caractère métallique.
Henri Étienne Sainte-Claire Deville a développé la première méthode de production commerciale en 1854, substituant le sodium au potassium dans les réactions de réduction et atteignant une échelle suffisante pour des applications industrielles. Le mécénat de Napoléon III a soutenu son développement précoce, l'aluminium étant initialement plus précieux que l'or en raison des difficultés de production et de sa rareté. Son appellation de « l'argent de l'argile » reflétait à la fois son apparence et son abondance géologique dans les minéraux alumino-silicatés.
Une avancée révolutionnaire a eu lieu en 1886 avec le développement simultané des procédés électrolytiques par Paul Héroult en France et Charles Martin Hall aux États-Unis. Le procédé Hall-Héroult a permis une production à grande échelle en éliminant les réducteurs chimiques coûteux, utilisant plutôt l'énergie électrique pour la réduction directe des oxydes dans des électrolytes fluorés fondus. Cette innovation a réduit les prix de l'aluminium de plus de 95% en une décennie, transformant l'élément d'un métal précieux en une matière première industrielle.
Le développement du procédé d'extraction de l'alumine par Karl Josef Bayer en 1887 a complété la base industrielle, fournissant un moyen efficace de purifier les minerais de bauxite et de produire un oxyde d'aluminium de haute qualité destiné à la réduction électrolytique. L'intégration des procédés Bayer et Hall-Héroult a établi l'industrie moderne de l'aluminium, permettant des applications en aérospatiale, transports et construction définissant la science des matériaux contemporaine.
Conclusion
La position de l'aluminium dans le tableau périodique et sa combinaison unique de propriétés physiques et chimiques établissent son importance fondamentale en chimie et technologie modernes. Sa configuration électronique détermine des comportements caractéristiques incluant la formation d'états d'oxydation +3 stables, une réactivité amphotère et une forte tendance à former des oxydes conférant une protection contre la corrosion. Sa faible densité combinée à des propriétés mécaniques excellentes lorsqu'allié crée une utilité exceptionnelle pour des applications sensibles au poids allant des structures aérospatiales à l'électronique grand public.
L'importance industrielle s'étend au-delà des applications actuelles vers des technologies émergentes incluant la fabrication additive, les systèmes de stockage d'énergie et les matériaux composites avancés. Les orientations de recherche se concentrent sur les alliages nanostructurés, les techniques de modification de surface et l'optimisation du recyclage pour répondre aux préoccupations de durabilité tout en étendant ses capacités de performance. Son abondance et son infrastructure établie d'extraction positionnent l'aluminium comme un matériau clé pour le développement technologique futur à travers diverses disciplines d'ingénierie.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
