| Élément | |
|---|---|
70YbYtterbium173.0432
8 18 32 8 2 |
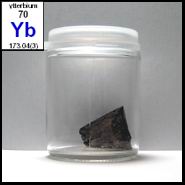
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 70 |
| Masse atomique | 173.043 amu |
| Famille d'éléments | N/A |
| Période | 6 |
| Groupe | 2 |
| Bloc | s-block |
| Année découverte | 1878 |
| Distribution des isotopes |
|---|
168Yb 0.13% 170Yb 3.05% 171Yb 14.3% 172Yb 21.9% 173Yb 16.12% 174Yb 31.8% 176Yb 12.7% |
170Yb (3.05%) 171Yb (14.30%) 172Yb (21.90%) 173Yb (16.12%) 174Yb (31.80%) 176Yb (12.70%) |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 6.965 g/cm3 (STP) |
(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 824 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 1193 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | +3 (0, +1, +2) |
| Potentiel de première ionisation | 6.254 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | -0.020 eV |
Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 1.1 |
Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |
| Rayon atomique | |
|---|---|
| Rayon covalent | 1.7 Å |
(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |
| Rayon métallique | 1.76 Å |
Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |
| Composés | ||
|---|---|---|
| Formule | Nom | État d'oxydation |
| YbBiPt | YbBiPt | +2 |
| YbCl2 | Chlorure d'ytterbium(II) | +2 |
| YbF2 | Fluorure d'ytterbium(II) | +2 |
| YbH2 | Hydrure d'ytterbium | +2 |
| YbS | Sulfure d'ytterbium | +2 |
| Yb2O3 | Oxyde d'ytterbium(III) | +3 |
| LaYbO3 | Oxyde de lanthane et d'ytterbium | +3 |
| Yb(CH3COO)3 | Acétate d'ytterbium(III) | +3 |
| Yb(NO3)3 | Nitrate d'ytterbium(III) | +3 |
| Yb2(SO4)3 | Sulfate d'ytterbium(III) | +3 |
| Yb2S3 | Sulfure d'ytterbium(III) | +3 |
| YbBr3 | Bromure d'ytterbium(III) | +3 |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| Configuration électronique | [Xe] 4f14 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 16 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Ytterbium (Yb) : Élément du tableau périodique
Résumé
L'ytterbium (Yb, numéro atomique 70) représente le quatorzième élément de la série des lanthanides, distingué par sa configuration électronique à couche fermée [Xe] 4f14 6s2. Cette configuration confère une stabilité exceptionnelle à l'état d'oxydation +2, faisant de l'ytterbium un des rares lanthanides formant facilement des composés divalents. L'élément présente une masse atomique standard de 173,045 ± 0,010 u et existe sous sept isotopes stables naturels. L'ytterbium démontre une densité plus faible (6,973 g/cm³), un point de fusion (824 °C) et un point d'ébullition (1196 °C) inférieurs à ceux des lanthanides environnants, caractéristiques directement liées à sa structure électronique. Les applications industrielles se concentrent principalement sur la technologie laser, les horloges atomiques et les procédés métallurgiques spécialisés.
Introduction
L'ytterbium occupe une position distinctive au sein de la série des lanthanides, démontrant un comportement chimique qui s'écarte notablement de celui des terres rares typiques. Les quatorze électrons f de l'élément créent une configuration à couche fermée stabilisant les états d'oxydation inférieurs, particulièrement le +2 inhabituel chez les lanthanides. Cette organisation électronique influence non seulement la réactivité chimique, mais aussi les propriétés physiques, entraînant des caractéristiques de densité et de thermiques distinctes des éléments voisins. L'élément cristallise dans une structure cubique à faces centrées à température ambiante, contrairement à l'empilement hexagonal compact typique des lanthanides. Découvert par Jean Charles Galissard de Marignac en 1878, l'ytterbium est passé d'une curiosité de laboratoire à un élément d'importance technologique considérable, notamment dans les applications de précision temporelle et les systèmes laser haute puissance.
Propriétés physiques et structure atomique
Paramètres atomiques fondamentaux
L'ytterbium présente un numéro atomique de 70 avec une configuration électronique [Xe] 4f14 6s2. La sous-couche 4f complètement remplie crée une stabilité électronique exceptionnelle et influence profondément les propriétés chimiques. Le rayon atomique mesure 176 pm, tandis que le rayon ionique pour Yb³⁺ est de 86,8 pm et pour Yb²⁺ de 102 pm. Ces rayons ioniques reflètent l'effet de contraction lanthanique, moins prononcé en raison de la configuration à f-shell rempli. La charge nucléaire effective subit un blindage minimal par les électrons 4f, contribuant aux propriétés uniques de l'élément. L'énergie de première ionisation est de 603,4 kJ/mol, la deuxième ionisation atteint 1174,8 kJ/mol, et la troisième grimpe à 2417 kJ/mol. L'écart important entre les deuxième et troisième énergies d'ionisation démontre la stabilité relative de l'ion Yb²⁺.
Caractéristiques physiques macroscopiques
L'ytterbium apparaît comme un métal gris-blanc argenté avec une teinte jaune pâle à l'état frais. L'élément présente trois formes allotropiques désignées alpha, beta et gamma. L'allotrope beta prédomine à température ambiante avec une densité de 6,966 g/cm³ et une structure cristalline cubique à faces centrées. La forme alpha, stable sous -13 °C, possède une structure hexagonale avec une densité de 6,903 g/cm³. L'allotrope gamma, existant au-delà de 795 °C, démontre une symétrie cubique centrée avec une densité de 6,57 g/cm³. Ces valeurs de densité sont significativement plus faibles que celles du thulium (9,32 g/cm³) et du lutécium (9,841 g/cm³), reflétant l'influence de la configuration électronique à couche fermée sur la liaison métallique. Le point de fusion de 824 °C et le point d'ébullition de 1196 °C représentent la plus petite plage liquide parmi tous les métaux, s'étendant seulement sur 372 °C. La conductivité thermique mesure 38,5 W/(m·K) à 300 K, tandis que la résistivité électrique à température ambiante est de 25,0 × 10⁻⁸ Ω·m.
Propriétés chimiques et réactivité
Structure électronique et comportement de liaison
Le comportement chimique de l'ytterbium est dominé par sa configuration électronique [Xe] 4f14 6s2, permettant avec une facilité inhabituelle les états d'oxydation +2 et +3. La couche f remplie confère une stabilité exceptionnelle à l'état divalent, rendant Yb²⁺ analogue à de nombreux cations des métaux alcalino-terreux. Contrairement aux autres lanthanides où trois électrons participent à la liaison métallique, seuls deux électrons 6s sont disponibles dans l'ytterbium, entraînant un rayon métallique accru et une énergie de cohésion réduite. L'élément forme principalement des composés ioniques, bien qu'un certain caractère covalent existe dans les complexes organométalliques. Les nombres de coordination varient généralement entre 6 et 9, avec une préférence pour des nombres élevés en solution aqueuse où les complexes nonahydratés [Yb(H₂O)₉]³⁺ prédominent. Les longueurs de liaison dans les composés de l'ytterbium reflètent les rayons ioniques, avec des liaisons Yb-O typiquement mesurées entre 2,28 et 2,35 Å pour la coordination octaédrique.
Propriétés électrochimiques et thermodynamiques
L'ytterbium présente une électronégativité de 1,1 sur l'échelle de Pauling et de 1,06 sur celle d'Allred-Rochow, indiquant un caractère fortement électropositif. Le potentiel de réduction standard pour le couple Yb³⁺/Yb est de -2,19 V, tandis que le potentiel Yb²⁺/Yb mesure -2,8 V. Ces valeurs reflètent le caractère réducteur puissant de l'élément, particulièrement à l'état divalent. L'affinité électronique est d'environ 50 kJ/mol, cohérente avec un comportement métallique. Les énergies successives d'ionisation montrent la stabilité des différents états d'oxydation, l'augmentation importante entre la deuxième et la troisième énergie d'ionisation (1174,8 à 2417 kJ/mol) soulignant la préférence pour les composés divalents. Les calculs thermodynamiques indiquent que les composés de l'ytterbium(II) sont thermodynamiquement instables en solution aqueuse, se décomposant facilement pour libérer de l'hydrogène. L'enthalpie de formation de Yb₂O₃ est de -1814,2 kJ/mol, tandis que celle de YbO est de -580,7 kJ/mol, démontrant la plus grande stabilité thermodynamique des composés trivalents à l'état solide.
Composés chimiques et formation de complexes
Composés binaires et ternaires
L'ytterbium forme une vaste série de composés binaires, les halogénures étant les exemples les plus caractérisés. Les trihalogénures YbF₃, YbCl₃, YbBr₃ et YbI₃ cristallisent tous dans des structures lanthaniques caractéristiques, YbF₃ adoptant la structure tysonite et les trihalogénures plus lourds la structure hexagonale UCl₃. Les enthalpies de formation sont de -1670, -959, -863 et -671 kJ/mol respectivement pour le fluorure, le chlorure, le bromure et l'iodure. Les dihalogénures YbF₂, YbCl₂, YbBr₂ et YbI₂ présentent des structures de type fluorine similaires aux halogénures alcalino-terreux, bien qu'ils soient thermiquement instables à haute température, se disproporcionnant selon la réaction 3YbX₂ → 2YbX₃ + Yb. La chimie des oxydes inclut la sesquioxyde Yb₂O₃ avec la structure C des terres rares et la monooxyde YbO de structure NaCl. Les sulfures, séléniures et tellurures suivent des schémas similaires, YbS, YbSe et YbTe adoptant des structures de type NaCl. Les composés ternaires incluent des grenats comme Yb₃Al₅O₁₂ et des dérivés de pérovskite tels que YbAlO₃.
Chimie de coordination et composés organométalliques
La chimie de coordination de l'ytterbium englobe à la fois les complexes divalents et trivalents, les effets du champ ligand jouant un rôle mineur en raison de la configuration f remplie. En solution aqueuse, les complexes nonahydratés [Yb(H₂O)₉]³⁺ dominent, bien que des nombres de coordination inférieurs apparaissent avec des ligands volumineux. Les éthers de couronne et les cryptands stabilisent l'état divalent par coordination sélective. La chimie organométallique inclut des complexes cyclopentadiényliques comme (C₅H₅)₂Yb et (C₅H₅)₃Yb, utilisés comme précurseurs dans diverses applications synthétiques. Le bis(cyclooctatétrényl)ytterbium représente un complexe sandwich important avec des propriétés magnétiques inhabituelles. Les complexes mixtes incorporant phosphines, amines et donneurs oxygénés montrent des géométries variées selon les exigences stériques. Les composés organométalliques divalents présentent des propriétés réductrices fortes et trouvent des applications en synthèse organique pour les réactions de formation de liaisons carbone-carbone.
Présence naturelle et analyse isotopique
Distribution géochimique et abondance
L'ytterbium se trouve dans la croûte terrestre à une concentration moyenne de 3,0 mg/kg (3,0 ppm), plus abondant que l'étain, le plomb ou le bismuth mais moins commun que la plupart des autres lanthanides. L'élément suit un comportement géochimique typique des lanthanides, se concentrant dans les roches ignées par cristallisation fractionnée. Les sources minérales principales incluent la monazite [(Ce,La,Nd,Th)PO₄], où l'ytterbium remplace les lanthanides plus légers à environ 0,03 %, la xenotime (YPO₄) et l'euxénite [(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)₂O₆]. Les argiles à adsorption ionique du sud de la Chine constituent la source la plus économiquement significative, avec des concentrations atteignant 0,05 à 0,15 % du total des terres rares. L'élément montre une compatibilité modérée dans les minéraux formateurs de roches, les coefficients de distribution favorisant les phases résiduelles lors de la fusion partielle. Les processus d'altération mobilisent généralement l'ytterbium, entraînant une concentration secondaire dans les minéraux argileux et les dépôts phosphatés.
Propriétés nucléaires et composition isotopique
L'ytterbium naturel comprend sept isotopes stables : ¹⁶⁸Yb (0,13 %), ¹⁷⁰Yb (3,04 %), ¹⁷¹Yb (14,28 %), ¹⁷²Yb (21,83 %), ¹⁷³Yb (16,13 %), ¹⁷⁴Yb (31,83 %) et ¹⁷⁶Yb (12,76 %). L'isotope le plus abondant, ¹⁷⁴Yb, possède un spin nucléaire I = 0, tandis que ¹⁷¹Yb et ¹⁷³Yb présentent des spins nucléaires I = 1/2. Ces propriétés isotopiques s'avèrent cruciales pour les applications en résonance magnétique nucléaire et la recherche en informatique quantique. Trente-deux radioisotopes ont été caractérisés, ¹⁶⁹Yb étant l'isotope artificiel le plus stable (demi-vie de 32,0 jours). Cet isotope se désintègre par capture électronique en ¹⁶⁹Tm avec émission gamma aux énergies de 63,1, 109,8, 177,2 et 307,7 keV. D'autres radioisotopes notables incluent ¹⁷⁵Yb (demi-vie 4,18 jours) et ¹⁶⁶Yb (demi-vie 56,7 heures). La section efficace de capture neutronique thermique pour ¹⁷⁴Yb est de 69 barns, facilitant la production de radioisotopes dans les réacteurs nucléaires.
Production industrielle et applications technologiques
Méthodologies d'extraction et de purification
La production industrielle d'ytterbium commence par le traitement des minerais de monazite ou des argiles à adsorption ionique par digestion acide avec de l'acide sulfurique concentré à 200-250 °C. Le mélange de terres rares obtenu est séparé par chromatographie d'échange d'ions utilisant des résines synthétiques chargées avec de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) ou des agents complexants similaires. La séparation de l'ytterbium exploite les légères différences des constantes de formation des complexes lanthanide-ligand. L'extraction par solvant avec de l'acide di(2-éthylhexyl)phosphorique (D2EHPA) ou du phosphate de tributyle offre des routes alternatives, particulièrement pour les opérations à grande échelle. Le processus de purification atteint généralement 99,9 % de pureté par cycles répétés. La production métallique implique la réduction de YbCl₃ anhydre par le calcium ou le lanthane métallique à 1000 °C sous vide élevé. Des méthodes alternatives incluent l'électrolyse d'un mélange eutectique fondu de YbCl₃-NaCl-KCl à 800 °C. La production mondiale est estimée à environ 50 tonnes annuelles, principalement issues de sources chinoises représentant plus de 90 % de l'offre mondiale.
Applications technologiques et perspectives futures
Les applications contemporaines de l'ytterbium exploitent ses propriétés nucléaires et électroniques uniques pour des usages spécialisés. Les horloges atomiques intégrant des atomes d'ytterbium refroidis par laser atteignent une stabilité sans précédent, avec une incertitude de fréquence inférieure à 10⁻¹⁹. Ces systèmes reposent sur la transition ¹S₀ → ³P₀ à 578 nm dans ¹⁷¹Yb, offrant une raie étroite adaptée à la métrologie de précision. La technologie des lasers à fibre utilise Yb³⁺ comme dopant actif dans des matrices de verre silicaté, permettant des opérations continues et pulsées haute puissance aux longueurs d'onde 1030-1100 nm. Le défaut quantique réduit (≈6 %) entre les longueurs d'onde de pompage et d'émission diminue la charge thermique, autorisant une montée en puissance jusqu'à des niveaux kilowattiques. La recherche en informatique quantique exploite les ions ¹⁷¹Yb⁺ piégés dans des champs radiofréquence comme qubits, les transitions optiques permettant des opérations de portes quantiques et la manipulation d'états. La médecine nucléaire utilise ¹⁶⁹Yb comme source gamma pour des systèmes de radiographie portables, rivalisant efficacement avec les générateurs de rayons X conventionnels dans des applications spécifiques. Les applications métallurgiques incluent des ajouts mineurs à l'acier inoxydable pour le raffinement de grain et la surveillance des contraintes via les effets piézorésistifs.
Développement historique et découverte
La découverte de l'ytterbium remonte à 1878 lorsque le chimiste suisse Jean Charles Galissard de Marignac isola un nouveau composant du minéral l'érbia, qu'il nomma « ytterbia » en hommage à Ytterby, village suédois près du site de découverte. Marignac soupçonnait que l'ytterbia contenait un élément inconnu, qu'il désigna comme l'ytterbium. L'histoire de l'élément se compliqua en 1907 lorsque trois chercheurs indépendants—Georges Urbain à Paris, Carl Auer von Welsbach à Vienne et Charles James au New Hampshire—démontrèrent simultanément que l'ytterbia de Marignac renfermait deux éléments distincts. Urbain sépara « néoytterbia » (ytterbium moderne) et « lutécia » (lutécium moderne), tandis que Welsbach identifia « aldebaranium » et « cassiopeium » pour les mêmes éléments. Des disputes de priorité opposèrent Urbain et Welsbach, finalement résolues en 1909 par la Commission des masses atomiques favorisant la nomenclature d'Urbain. Le premier ytterbium métallique relativement pur fut obtenu en 1953 grâce aux techniques de purification par échange d'ions développées durant le Projet Manhattan. Les décennies suivantes virent une compréhension croissante de la chimie unique de l'ytterbium, particulièrement la stabilité de son état d'oxydation divalent et ses applications en technologie avancée.
Conclusion
L'ytterbium occupe une niche distinctive dans la série des lanthanides en raison de sa configuration électronique 4f¹⁴ à couche fermée, conférant une stabilité inhabituelle à l'état d'oxydation +2 et influençant pratiquement toutes ses propriétés chimiques et physiques. Sa densité réduite, son point de fusion plus bas et ses préférences de coordination le distinguent des autres métaux de terres rares, tandis que ses propriétés nucléaires uniques permettent des applications de pointe en informatique quantique et en métrologie de précision. Les recherches futures visent à développer des techniques de séparation plus efficaces, à exploiter ses propriétés quantiques pour des applications en informatique avancée et à étendre les capacités des lasers haute puissance. Son rôle dans les technologies émergentes suggère une importance continue malgré son abondance naturelle limitée et ses exigences d'extraction complexes.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
