| Élément | |
|---|---|
74WTungstène183.8412
8 18 32 12 2 |
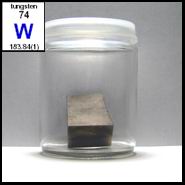
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 74 |
| Masse atomique | 183.841 amu |
| Famille d'éléments | Les métaux de transition |
| Période | 6 |
| Groupe | 2 |
| Bloc | s-block |
| Année découverte | 1781 |
| Distribution des isotopes |
|---|
180W 0.130% 182W 26.30% 186W 28.60% |
182W (47.79%) 186W (51.97%) |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 19.25 g/cm3 (STP) |
(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 3407 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 5927 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | +4, +6 (-4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +5) |
| Potentiel de première ionisation | 7.980 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | 0.816 eV |
Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 2.36 |
Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |
| Rayon atomique | |
|---|---|
| Rayon covalent | 1.37 Å |
(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |
| Rayon métallique | 1.39 Å |
Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |
| Composés | ||
|---|---|---|
| Formule | Nom | État d'oxydation |
| WC | Le carbure de tungstène | +2 |
| WSi2 | Disiliciure de tungstène | +2 |
| W2O3 | Oxyde de tungstène (III) | +3 |
| WI3 | Iodure de tungstène (III) | +3 |
| WBr4 | Bromure de tungstène (IV) | +4 |
| WCl4 | Chlorure de tungstène (IV) | +4 |
| WF4 | Fluorure de tungstène (IV) | +4 |
| WO2 | Oxyde de tungstène (IV) | +4 |
| WBr5 | Bromure de tungstène (V) | +5 |
| WF6 | Fluorure de tungstène (VI) | +6 |
| WCl6 | Chlorure de tungstène (VI) | +6 |
| H2WO4 | Acide tungstique | +6 |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| Configuration électronique | [Xe] 4f14 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 6 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Tungstène (W) : Élément du tableau périodique
Résumé
Le tungstène (W, numéro atomique 74) représente l'élément métallique le plus réfractaire du tableau périodique, possédant le point de fusion le plus élevé (3695 K) et le point d'ébullition le plus élevé (6203 K) parmi tous les éléments connus. Avec une densité de 19,25 g/cm³, le tungstène démontre une stabilité structurelle exceptionnelle et une résistance à la déformation thermique. Sa configuration électronique [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² le place dans le groupe 6 des métaux de transition, conférant des caractéristiques de liaison uniques et des états d'oxydation variant de -2 à +6. Ses principales applications industrielles concernent la production de carbure de tungstène et les alliages réfractaires. Il se trouve naturellement dans les minerais de wolframite et de scheelite, avec une production mondiale concentrée dans des gisements stratégiques. Son activité biologique reste limitée, bien que certains organismes extrêmophiles utilisent des enzymes contenant du tungstène dans des voies métaboliques spécialisées.
Introduction
Le tungstène occupe une position distinctive dans la science des matériaux moderne en tant qu'élément possédant les propriétés thermiques extrêmes parmi tous les métaux. Situé à la période 6, groupe 6 du tableau périodique, il présente des caractéristiques de structure électronique typiques des métaux de transition de la troisième ligne tout en maintenant des propriétés physiques uniques qui le distinguent des éléments voisins. Son numéro atomique 74 correspond à une configuration nucléaire soutenant une stabilité atomique exceptionnelle.
La découverte du tungstène s'est effectuée par l'analyse systématique des minerais de wolframite en 1781, la forme métallique ayant été isolée en 1783. L'élément démontre une résistance remarquable à l'attaque chimique dans des conditions normales, nécessitant des techniques d'extraction spécialisées pour sa production commerciale. Son importance industrielle provient principalement des applications exigeant une extrême dureté, une haute densité et une stabilité thermique, en faisant un matériau critique dans la fabrication avancée et les applications militaires.
Propriétés physiques et structure atomique
Paramètres atomiques fondamentaux
Le tungstène possède un numéro atomique 74 et une masse atomique standard de 183,84 ± 0,01 u. Sa configuration électronique suit le schéma [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s², plaçant quatre électrons dans la sous-couche 5d et deux dans l'orbitale 6s. Cette configuration entraîne un recouvrement orbital significatif et des caractéristiques de liaison métallique fortes.
Les mesures de rayon atomique indiquent un rayon métallique de 139 pm et un rayon covalent de 162 pm pour les liaisons simples. La charge nucléaire effective subit un écran important de la part des couches électroniques internes, bien que les électrons 5d participent activement aux interactions de liaison. Les énergies d'ionisation montrent la difficulté progressive d'arrachement des électrons : première énergie d'ionisation de 770 kJ/mol, seconde énergie d'ionisation de 1700 kJ/mol, les valeurs suivantes augmentant rapidement en raison de l'implication des électrons du cœur.
Caractéristiques physiques macroscopiques
Le tungstène pur présente un éclat métallique grisâtre-blanc avec une réflectivité de surface exceptionnelle. L'analyse de la structure cristalline révèle un réseau cubique centré (bcc) dans des conditions normales, avec un paramètre de réseau a = 3,165 Å. Cette structure bcc fournit une efficacité optimale d'empilement atomique adaptée aux dimensions atomiques du tungstène tout en maintenant une stabilité structurelle sur une large gamme de températures.
Les propriétés thermiques établissent le tungstène comme l'élément métallique le plus réfractaire. La fusion intervient à 3695 K (3422°C), représentant le point de fusion le plus élevé parmi tous les éléments. Le point d'ébullition atteint 6203 K (5930°C), également maximal pour les substances élémentaires. L'enthalpie de fusion mesure 52,31 kJ/mol, tandis que l'enthalpie de vaporisation est de 806,7 kJ/mol. La capacité thermique spécifique à 298 K est de 24,27 J/(mol·K).
Les mesures de densité donnent 19,25 g/cm³ dans des conditions normales, plaçant le tungstène parmi les éléments naturels les plus denses. Cette densité s'approche de celle de l'or (19,32 g/cm³) et dépasse celle du platine (21,45 g/cm³). Les variations de densité en fonction de la température suivent des modèles d'expansion métallique typiques, avec un coefficient d'expansion linéaire de 4,5 × 10⁻⁶ K⁻¹.
Propriétés chimiques et réactivité
Structure électronique et comportement de liaison
La réactivité chimique du tungstène provient de la disponibilité des électrons 5d⁴ 6s² pour les interactions de liaison. L'élément présente des états d'oxydation variables de -2 à +6, les états +4 et +6 étant les configurations les plus stables thermodynamiquement. Les états d'oxydation inférieurs apparaissent principalement dans des complexes organométalliques ou des environnements de composés réduits.
Les caractéristiques de liaison covalente impliquent une participation étendue des orbitales d, entraînant des liaisons directionnelles et des géométries complexes. Les énergies de liaison pour les interactions tungstène-carbone atteignent 627 kJ/mol dans le carbure de tungstène, représentant certaines des liaisons métal-carbone les plus fortes connues. La liaison métal-métal dans les agrégats de tungstène démontre une solidité exceptionnelle, les distances W-W variant de 2,2 à 2,8 Å selon l'environnement de coordination.
Les schémas d'hybridation dans les composés du tungstène impliquent des configurations d²sp³ pour les géométries octaédriques et des configurations d³s pour les arrangements tétraédriques. Le vaste ensemble d'orbitales d permet la formation de liaisons multiples avec des ligands appropriés, notamment des fonctions oxo et imido.
Propriétés électrochimiques et thermodynamiques
Les valeurs d'électronégativité placent le tungstène à 2,36 sur l'échelle de Pauling et à 4,40 eV sur celle de Mulliken, indiquant une capacité d'attraction électronique modérée par rapport aux autres métaux de transition. Cette électronégativité intermédiaire permet la formation de composés ioniques et covalents selon le partenaire de liaison.
La progression des énergies d'ionisation suit un comportement typique des métaux de transition : la première ionisation nécessite 770 kJ/mol, la seconde 1700 kJ/mol, la troisième 2300 kJ/mol et la quatrième 3400 kJ/mol. Les mesures d'affinité électronique indiquent une tendance minimale à la formation d'anions, avec des valeurs proches de zéro ou légèrement positives.
Les potentiels de réduction standard varient considérablement selon l'état d'oxydation et les conditions de pH. Le couple W⁶⁺/W présente E° = -0,090 V en solution acide, tandis que le couple W³⁺/W montre E° = -0,11 V. Ces potentiels négatifs indiquent la stabilité thermodynamique de la forme métallique dans des conditions normales. Le comportement dépendant du pH suit les prédictions des diagrammes de Pourbaix, avec une formation d'oxydes favorisée en conditions oxydantes.
Composés chimiques et formation de complexes
Composés binaires et ternaires
Les composés d'oxyde de tungstène représentent les systèmes binaires les plus étudiés. Le trioxyde de tungstène (WO₃) constitue la phase d'oxyde principale, cristallisant sous plusieurs modifications polymorphiques. La forme la plus stable présente une structure déformée de type ReO₃ avec des distances W-O de 1,78 à 2,41 Å. Sa formation s'effectue par oxydation directe à haute température, sa stabilité thermodynamique s'étendant jusqu'à 1900 K.
Le dioxyde de tungstène (WO₂) illustre la chimie des états d'oxydation inférieurs, se formant par réduction du trioxyde sous atmosphère hydrogène. L'analyse de la structure cristalline révèle un arrangement de type rutile avec des propriétés de conductivité métallique. Des phases intermédiaires d'oxydation incluant W₂O₅ et W₃O₈ existent sous des conditions spécifiques de température et de pression.
Les composés halogénés suivent des schémas prévisibles d'états d'oxydation. L'hexafluorure de tungstène (WF₆) représente le plus haut état d'oxydation halogéné, existant sous forme de solide jaune volatil avec une géométrie moléculaire octaédrique. Les analogues hexachlorure et hexabromure présentent des caractéristiques structurelles similaires avec une stabilité thermique réduite progressivement. Les halogénures inférieurs comme WCl₄ et WBr₄ adoptent des structures polymériques avec des liaisons métal-métal.
Le carbure de tungstène (WC) constitue le composé binaire le plus important industriellement. La structure cristalline montre un empilement hexagonal compact des atomes de tungstène avec les atomes de carbone occupant les interstices octaédriques. Les longueurs de liaison W-C de 2,06 Å contribuent à une dureté exceptionnelle (2600-3000 HV) et une stabilité thermique élevée. Sa formation nécessite un traitement à haute température (>2000 K) dans un environnement riche en carbone.
Chimie de coordination et composés organométalliques
Les complexes de coordination du tungstène couvrent des états d'oxydation de 0 à +6, avec des géométries variant de l'octaédrique au tétraédrique selon le nombre d'électrons d et les exigences des ligands. L'hexacarbonyle de tungstène (W(CO)₆) illustre la chimie de coordination à valence zéro, adoptant une géométrie octaédrique parfaite avec des distances W-C de 2,058 Å.
Les complexes oxo sont des motifs de coordination fréquents aux états d'oxydation élevés. Les anions tungstate incluant WO₄²⁻ et les polytungstates démontrent respectivement des coordinations tétraédriques et octaédriques. La chimie des polyoxométallates permet la formation d'anions complexes avec des architectures tridimensionnelles élaborées.
La chimie organométallique englobe des complexes d'alkylidène et d'alkylidyn présentant des liaisons multiples métal-carbone. Les complexes de type carbène de Schrock avec des centres tungstène démontrent une activité exceptionnelle dans les réactions de métathèse d'oléfines. La fonctionnalité W=CR₂ présente des longueurs de liaison proches de 1,90 Å avec un caractère double-liaison significatif. Les espèces d'alkylidyn W≡CR montrent des liaisons encore plus courtes (1,78 Å) avec un caractère triple-liaison formel.
Occurrence naturelle et analyse isotopique
Distribution géochimique et abondance
Le tungstène présente une abondance crustale limitée, mesurant environ 1,25 ppm dans les compositions moyennes de la croûte continentale. Cette rareté le place parmi les métaux de transition moins abondants, bien que des dépôts concentrés existent dans des environnements géologiques spécifiques. Son comportement géochimique reflète le rapport charge-rayon élevé des cations tungstène, favorisant la formation de complexes et la précipitation en conditions hydrothermales.
Les minerais principaux incluent la wolframite ((Fe,Mn)WO₄) et la scheelite (CaWO₄), la wolframite représentant la source mondiale dominante. Les dépôts de wolframite se forment par des processus hydrothermaux associés aux intrusions granitiques, particulièrement dans les environnements de greisen et de skarn. La scheelite se trouve dans des dépôts métamorphiques à haute température et des auréoles de contact.
Les schémas de distribution mondiale concentrent les ressources en tungstène dans des provinces géologiques spécifiques. La Chine domine la production avec environ 80% de la production mondiale, suivie par le Vietnam, la Russie et la Bolivie. Des dépôts significatifs existent dans la ceinture tungsténifère du sud de la Chine, où la minéralisation liée au granite a produit des gisements exceptionnels avec des teneurs variant de 0,1% à 1,5% WO₃.
Propriétés nucléaires et composition isotopique
Le tungstène naturel se compose de cinq isotopes stables avec la distribution suivante : ¹⁸⁰W (0,12%), ¹⁸²W (26,50%), ¹⁸³W (14,31%), ¹⁸⁴W (30,64%) et ¹⁸⁶W (28,43%). Cette composition isotopique reflète les processus de nucléosynthèse en environnement stellaire, les masses variant de six unités autour de la région d'abondance maximale.
Les valeurs de spin nucléaire varient selon les isotopes : ¹⁸³W présente un spin nucléaire I = 1/2, permettant des études spectroscopiques RMN, tandis que les isotopes à masse paire possèdent I = 0. Les moments magnétiques de l'isotope à masse impaire mesurent 0,117784 magnétons nucléaires. Ces propriétés nucléaires facilitent l'analyse isotopique par spectrométrie de masse et résonance magnétique nucléaire.
Les isotopes radioactifs présentent des modes de désintégration variés. ¹⁷⁹W subit une capture électronique avec t₁/₂ = 37,05 minutes, tandis que ¹⁸¹W présente une désintégration similaire avec t₁/₂ = 121,2 jours. Ces isotopes trouvent des applications en médecine nucléaire et en recherche radiochimique. Les sections efficaces neutroniques des isotopes du tungstène varient de 18,3 barns (¹⁸²W) à 37,9 barns (¹⁸⁶W), influençant son comportement dans les environnements de réacteurs nucléaires.
Production industrielle et applications technologiques
Méthodologies d'extraction et de purification
La production commerciale de tungstène commence par la concentration des minerais par séparation gravitationnelle et techniques de flottation. Les minerais de wolframite subissent une séparation magnétique pour éliminer les minéraux de gangue ferreux, tandis que le traitement de la scheelite repose sur une chimie de flottation optimisée pour la récupération du tungstate de calcium. Les concentrés atteignent généralement 65-75% de contenu WO₃.
Le traitement chimique convertit les concentrés en paratungstate d'ammonium (APT) via une décomposition alcaline et une cristallisation. La fusion par carbonate de sodium à 1100 K dissout les minerais de tungstate, suivie d'une acidification et d'une précipitation de l'acide tungstique. La purification par échange d'ions élimine le molybdène et d'autres contaminants avant la cristallisation de l'APT.
La production du tungstène métallique utilise la réduction par hydrogène du trioxyde de tungstène à des températures supérieures à 1100 K. La réduction se déroule en phases intermédiaires : WO₃ → WO₂,₉ → WO₂ → W. Le contrôle de la taille des particules et la composition de l'atmosphère influencent fortement les caractéristiques de la poudre et son comportement ultérieur de consolidation.
Les techniques de métallurgie des poudres permettent de densifier les poudres de tungstène. Le pressage-frittage à 2400-2600 K atteint une densité proche de la théorie tout en maintenant une structure de grains fins. Des approches alternatives comme le dépôt chimique en phase vapeur et le traitement plasma produisent des tungstènes spécialisés pour les applications électroniques.
Applications technologiques et perspectives futures
Les applications en carbure de tungstène dominent la consommation mondiale, représentant environ 50% de l'utilisation totale. Les carbures cémentés combinent le carbure de tungstène avec des liants cobalt ou nickel, produisant des outils de coupe et des composants résistants à l'usure. Ces matériaux permettent des opérations d'usinage à grande vitesse et prolongent la durée de vie des outils dans des environnements manufacturiers exigeants.
Les filaments d'éclairage incandescent représentent des applications traditionnelles, bien que la technologie LED ait réduit cette part du marché. Le point de fusion élevé et la faible pression de vapeur du tungstène restent pertinents dans des applications spéciales d'éclairage comme les lampes halogènes et les systèmes à décharge à haute intensité.
Les applications aérospatiales exploitent la densité et les propriétés thermiques du tungstène dans les tuyères de fusée, le blindage contre les radiations et les pénétrateurs d'énergie cinétique. Les applications militaires utilisent sa densité pour des projectiles perforants et des systèmes de contrepoids. Les applications électroniques incluent les cibles de tubes à rayons X et les émetteurs d'électrons dans les dispositifs sous vide.
Les applications émergentes explorent le rôle du tungstène dans la technologie des réacteurs à fusion, où les matériaux exposés au plasma doivent résister à des environnements thermiques et radiatifs extrêmes. Les recherches se poursuivent sur des matériaux composites à base de tungstène et des formes nanostructurées pour les systèmes énergétiques de nouvelle génération. Les techniques de fabrication additive élargissent les capacités de mise en œuvre du tungstène pour des applications géométriques complexes.
Développement historique et découverte
La découverte du tungstène provient d'investigations systématiques des phases minérales lourdes dans les régions minières européennes du XVIIIe siècle. Carl Wilhelm Scheele a identifié un nouvel acide à partir de scheelite en 1781, tandis que Juan José et Fausto Elhuyar ont isolé avec succès le tungstène métallique de la wolframite en 1783. Ces découvertes parallèles ont établi le tungstène comme un élément distinct possédant des propriétés uniques.
Les premières recherches métallurgiques ont révélé la dureté exceptionnelle et la stabilité thermique du tungstène, mais des limitations techniques ont empêché son utilisation à grande échelle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le développement de l'éclairage électrique a créé le premier marché majeur, Edison et d'autres inventeurs reconnaissant les avantages des filaments en tungstène par rapport aux alternatives en carbone.
Les périodes des guerres mondiales ont souligné l'importance stratégique du tungstène dans les applications d'armure et de munitions. La compétition pour les ressources en tungstène a influencé les relations géopolitiques, notamment concernant les dépôts portugais de wolframite. L'expansion industrielle post-guerre a conduit au développement d'outils en carbure de tungstène et à la technologie des carbures cémentés.
La science moderne du tungstène a évolué grâce aux avancées en métallurgie des poudres, en croissance cristalline et en modification de surfaces. La compréhension de ses propriétés nucléaires a permis des applications spécialisées dans la production d'isotopes médicaux et les composants de réacteurs nucléaires. Les recherches actuelles s'orientent vers des matériaux nanostructurés et des systèmes composites pour des environnements extrêmes.
Conclusion
Le tungstène maintient une position distinctive parmi les métaux de transition grâce à ses propriétés thermiques extrêmes, sa densité élevée et sa chimie variée en états d'oxydation. Ses caractéristiques uniques permettent des applications critiques dans la fabrication, l'aérospatiale, l'électronique et les systèmes énergétiques. Son importance stratégique stimule continuellement la recherche sur des ressources durables et les technologies de recyclage.
Les développements futurs en science du tungstène mettront probablement l'accent sur les matériaux nanostructurés, les techniques de fabrication avancées et des applications spécialisées dans les technologies énergétiques émergentes. Son rôle dans les systèmes de réacteurs à fusion et les applications nucléaires de nouvelle génération positionne le tungstène comme un élément croissant en importance pour les infrastructures énergétiques durables. L'étude continue de ses propriétés fondamentales et méthodes de traitement soutiendra l'expansion de ses applications technologiques.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
