| Élément | |
|---|---|
75ReRhénium186.20712
8 18 32 13 2 |
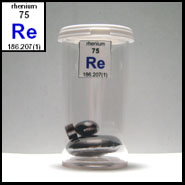
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 75 |
| Masse atomique | 186.2071 amu |
| Famille d'éléments | Les métaux de transition |
| Période | 6 |
| Groupe | 2 |
| Bloc | s-block |
| Année découverte | 1925 |
| Distribution des isotopes |
|---|
185Re 37.40% |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 21.02 g/cm3 (STP) |
H (H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 3180 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 5627 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | +4, +7 (-3, -1, 0, +1, +2, +3, +5, +6) |
| Potentiel de première ionisation | 7.877 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | 0.060 eV |
Nobelium (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 1.9 |
Césium (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |
| Rayon atomique | |
|---|---|
| Rayon covalent | 1.31 Å |
H (H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |
| Rayon métallique | 1.37 Å |
Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |
| Composés | ||
|---|---|---|
| Formule | Nom | État d'oxydation |
| Re(CO)5Br | Bromopentacarbonylrhénium(I) | +1 |
| ReH(CO)5 | Pentacarbonylhydridorhénium | +1 |
| ReB2 | Diborure de rhénium | +2 |
| K2Re2Cl8 | Octachlorodirhénate de potassium | +3 |
| ReI3 | Iodure de rhénium(III) | +3 |
| ReF4 | Tétrafluorure de rhénium | +4 |
| ReI4 | Tétraiodure de rhénium | +4 |
| ReCl5 | Pentachlorure de rhénium | +5 |
| ReF5 | Pentafluorure de rhénium | +5 |
| ReF6 | Hexafluorure de rhénium | +6 |
| ReO3 | Trioxyde de rhénium | +6 |
| AgReO4 | Perrhénate d'argent | +7 |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| Configuration électronique | [Xe] 4f14 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 7 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Rhénium (Re) : Élément du Tableau Périodique
Résumé
Le rhénium (Re, Z = 75) représente l'un des éléments naturels les plus rares de la croûte terrestre avec une abondance d'environ 1 partie par milliard. Ce métal de transition lourd, gris argenté, possède des propriétés physiques exceptionnelles, notamment le troisième point de fusion le plus élevé de tous les éléments à 3459 K, ainsi qu'une versatilité chimique remarquable couvrant des états d'oxydation allant de −1 à +7. L'élément démontre des configurations électroniques uniques permettant des liaisons métal-métal étendues dans les états d'oxydation bas, tout en formant des composés stables à haute oxydation comme Re₂O₇. Les applications industrielles se concentrent principalement sur les alliages superdurs à base de nickel utilisés en aérospatiale et les catalyseurs platine-rhénium employés dans le raffinage du pétrole.
Introduction
Le rhénium occupe la position 75 du tableau périodique en tant que membre du groupe 7 (famille du manganèse) et de la troisième série des métaux de transition. L'élément présente une stabilité thermique remarquable avec un point de fusion de 3459 K, dépassé uniquement par le tungstène et le carbone en température de sublimation. Sa découverte s'inscrit dans une histoire complexe avec une identification initiale erronée par Masataka Ogawa en 1908, puis confirmée par Walter Noddack, Ida Tacke et Otto Berg en 1925. La configuration électronique [Xe]4f¹⁴5d⁵6s² le positionne de manière unique parmi les métaux de transition, permettant la formation de liaisons quadruples métal-métal et couvrant la gamme la plus étendue d'états d'oxydation stables du groupe 7. Son importance industrielle découle de sa rareté, qui lui confère une valeur économique élevée, ainsi que de ses applications spécialisées nécessitant une stabilité extrême à haute température et une efficacité catalytique.
Propriétés Physiques et Structure Atomique
Paramètres Atomiques Fondamentaux
Le rhénium possède une masse atomique de 186,207 ± 0,001 u avec un noyau contenant 75 protons et principalement 112 neutrons dans l'isotope le plus abondant, le 187Re. La structure électronique [Xe]4f¹⁴5d⁵6s² montre des motifs caractéristiques des métaux de transition avec cinq électrons non appariés dans la sous-couche 5d. Les mesures du rayon atomique indiquent 137 pm pour le rayon métallique, tandis que les rayons ioniques varient fortement selon l'état d'oxydation : le Re³⁺ présente un rayon de 63 pm, alors que le Re⁷⁺ se contracte à 38 pm, reflétant les effets de la charge nucléaire accrue. Les calculs de charge nucléaire effective donnent environ 6,76 pour les électrons 6s externes, contribuant à l'énergie d'ionisation élevée de 760 kJ·mol⁻¹.
Caractéristiques Physiques Macroscopiques
Le rhénium métallique cristallise dans une structure hexagonale compacte avec des paramètres de réseau a = 276,1 pm et c = 445,6 pm, ce qui lui confère une densité exceptionnelle de 21,02 g·cm⁻³ à 293 K. L'élément démontre des propriétés thermiques extraordinaires, notamment un point de fusion de 3459 K, un point d'ébullition de 5869 K et une chaleur de fusion de 60,43 kJ·mol⁻¹. L'enthalpie de vaporisation atteint 704 kJ·mol⁻¹, reflétant la force des liaisons métalliques. Sa capacité thermique molaire est de 25,48 J·mol⁻¹·K⁻¹ dans des conditions standard. Le métal présente un éclat métallique gris argenté avec une forte réflectivité dans le spectre visible. Ses propriétés mécaniques incluent une ductilité exceptionnelle après recuit, permettant sa fabrication en fils fins et feuilles malgré sa nature réfractaire.
Propriétés Chimiques et Réactivité
Configuration Électronique et Comportement de Liaison
La configuration d⁵ permet au rhénium d'adopter des états d'oxydation allant de −1 à +7, les états +7, +4 et +3 étant les plus thermodynamiquement stables. Dans les états d'oxydation bas, des liaisons métal-métal étendues se produisent, illustrées par la liaison quadruple Re-Re dans [Re₂Cl₈]²⁻ avec une longueur de 224 pm et une énergie de liaison supérieure à 500 kJ·mol⁻¹. La chimie de coordination implique généralement des géométries octaédriques pour les complexes Re(IV) et Re(III), tandis que les composés de rhénium à haut état d'oxydation adoptent des arrangements tétraédriques. L'élément forme des liaisons covalentes stables avec les éléments électronégatifs, notamment l'oxygène et le fluor, permettant l'isolement de composés tels que ReF₇ et Re₂O₇.
Propriétés Électrochimiques et Thermodynamiques
Les valeurs d'électronégativité placent le rhénium à 1,9 sur l'échelle de Pauling, intermédiaire entre le manganèse (1,55) et l'osmium (2,2), reflétant sa capacité modérée d'attraction électronique. Les énergies d'ionisation successives montrent des tendances typiques des métaux de transition : première énergie d'ionisation 760 kJ·mol⁻¹, seconde 1260 kJ·mol⁻¹ et troisième 2510 kJ·mol⁻¹. Les potentiels de réduction standard varient considérablement selon l'état d'oxydation et les conditions : ReO₄⁻/Re présente un E° = +0,368 V en milieu acide, tandis que Re³⁺/Re affiche E° = +0,300 V. La stabilité inhabituelle de l'état d'oxydation +7 se manifeste par la formation thermodynamiquement favorisée de perrhénate sous conditions oxydantes.
Composés Chimiques et Formation de Complexes
Composés Binaires et Ternaires
La chimie des oxydes de rhénium englobe plusieurs stœchiométries reflétant ses états d'oxydation variables. Re₂O₇ est l'oxyde le plus stable, cristallisant dans une structure complexe avec des longueurs de liaison Re-O de 171 pm, et démontrant une volatilité élevée avec sublimation à 633 K. ReO₃ adopte la structure pérovskite cubique caractérisée par une conductivité métallique due à la formation extensive de ponts Re-O-Re. Les oxydes à bas état d'oxydation incluent ReO₂ (structure rutile) et Re₂O₃. La chimie des halogénures comprend l'ensemble complet des chlorures, bromures et iodures, avec ReCl₆ comme chlorure d'état d'oxydation le plus élevé. Le ReF₇ unique présente une géométrie pentagonale bipyramidale, constituant le seul heptafluorure neutre connu.
Chimie de Coordination et Composés Organométalliques
Les complexes de coordination du rhénium montrent une diversité extraordinaire couvrant des états d'oxydation formels de −1 à +7. L'anion archétypal [Re(CO)₅]⁻ présente une géométrie bipyramidale trigonale avec des longueurs de liaison Re-C de 200 pm, représentant l'état d'oxydation −1. La chimie des carbonyles se concentre sur Re₂(CO)₁₀, possédant une liaison Re-Re de 304 pm et servant de précurseur à la synthèse organométallique. Les complexes à haut état d'oxydation incluent le perrhénate [ReO₄]⁻ avec géométrie tétraédrique et distances Re-O de 172 pm. L'hydrure inhabituel [ReH₉]²⁻ démontre une coordination prismatique trigonale tricapée, représentant le nombre de coordination le plus élevé atteint par le rhénium.
Occurrence Naturelle et Analyse Isotopique
Distribution Géochimique et Abondance
L'abondance crustale du rhénium est d'environ 1,0 ppb en masse, le classant 77e élément le plus abondant et parmi les trois éléments stables les plus rares avec l'indium et le tellure. Son comportement géochimique montre des caractéristiques chalcophiles avec une concentration préférentielle dans les phases minérales sulfurées. Son occurrence principale implique le remplacement du molybdène dans la molybdénite (MoS₂), avec des concentrations généralement comprises entre 10 et 2000 ppm. Le volcan Kudriavy sur l'île Iturup abrite le seul dépôt minéral naturel connu, où le ReS₂ (rheniite) précipite directement des fumerolles volcaniques à des températures supérieures à 773 K. Les gisements chilien de cuivre porphyrique contiennent les plus grandes réserves mondiales de rhénium associé à la molybdénite.
Propriétés Nucléaires et Composition Isotopique
Le rhénium naturel se compose de deux isotopes avec une distribution d'abondance inhabituelle : le 185Re (37,4 % d'abondance, stable) et le 187Re (62,6 % d'abondance, radioactif avec t₁/₂ = 4,12 × 10¹⁰ ans). La désintégration bêta du 187Re en 187Os se produit avec une énergie de désintégration de 2,6 keV, représentant la seconde plus faible énergie de désintégration connue parmi tous les radionucléides. Ce processus permet la datation par rhénium-osmium des dépôts miniers avec une précision remontant aux âges précambriens. Les états de spin nucléaire indiquent pour le 185Re un spin I = 5/2 et un moment magnétique μ = 3,1871 magnéton nucléaire, tandis que le 187Re présente I = 5/2 et μ = 3,2197 magnéton nucléaire. Les isotopes artificiels s'étendent de 160Re à 194Re, avec des applications médicales pour le 186Re (t₁/₂ = 90,6 heures) et le 188Re (t₁/₂ = 17,0 heures).
Production Industrielle et Applications Technologiques
Méthodologies d'Extraction et de Purification
La récupération industrielle du rhénium utilise principalement des procédés de torréfaction de molybdénite où l'élévation de température à 973-1073 K volatilise le rhénium sous forme de Re₂O₇ avec une pression vapeur atteignant 133 Pa à 633 K. L'épuration des gaz de combustion par solutions aqueuses produit de l'acide perrhénique (HReO₄), qui précipite ensuite avec du chlorure de potassium ou d'ammonium pour former des sels cristallins de perrhénate. La purification par recristallisation atteint des niveaux de pureté supérieurs à 99,99 %. Une méthode alternative d'extraction à partir des solutions de lixiviation in situ de l'uranium représente une technologie émergente, avec des coefficients de sélectivité pour le rhénium atteignant 10⁴. La production mondiale annuelle est estimée à 45-50 tonnes, concentrée au Chili (60 %), aux États-Unis (15 %) et au Pérou (10 %), le recyclage contribuant à environ 15 tonnes supplémentaires par an.
Applications Technologiques et Perspectives Futures
Les applications aérospatiales consomment environ 70 % de la production mondiale de rhénium via des formulations d'alliages superdurs à base de nickel contenant 3-6 % en masse de rhénium pour la fabrication de pales de turbine. Ces applications exploitent la capacité du rhénium à améliorer la résistance à la déformation lente à des températures supérieures à 1273 K par des mécanismes de renforcement en solution solide et l'augmentation de la stabilité de la phase gamma prime. Les applications catalytiques représentent 25 % de la consommation, notamment dans les catalyseurs de reformage platine-rhénium où la teneur en rhénium varie généralement entre 0,3-0,8 % en masse. Sa résistance à l'empoisonnement catalytique par les composés soufrés permet une sélectivité élevée dans la production d'hydrocarbures aromatiques. Les applications émergentes incluent les matériaux pour joints à haute pression dans les cellules à enclume de diamant, les éléments de thermocouples pour mesures à température extrême, et des anodes spécialisées pour rayons X exploitant son numéro atomique élevé.
Développement Historique et Découverte
La chronologie de la découverte du rhénium comprend plusieurs phases, commençant par l'identification initiale de Masataka Ogawa en 1908, dont les preuves spectroscopiques furent ultérieurement confirmées comme correspondant à l'élément 75 plutôt qu'au 43 comme initialement affirmé. L'analyse de Ogawa sur la thorénite employa des techniques de spectroscopie d'arc révélant des raies d'émission caractéristiques aux longueurs d'onde 346,1, 346,5 et 488,1 nm. La vérification scientifique eut lieu en 1925 lorsque Walter Noddack, Ida Tacke et Otto Berg utilisèrent la spectroscopie X pour identifier le rhénium dans des concentrés de minerai de platine et des spécimens de colombo-tantalite. Leur approche systématique impliqua des techniques de séparation chimique suivies de la confirmation spectroscopique des raies d'émission Lα et Kα caractéristiques. L'isolement industriel devint significatif en 1928 avec l'extraction de 1 gramme à partir de 660 kg de molybdénite, établissant les propriétés chimiques fondamentales et confirmant les prédictions théoriques du système périodique de Mendeleïev.
Conclusion
La position du rhénium en tant que dernier élément stable découvert établit son importance unique dans l'achèvement du tableau périodique et dans la science des matériaux moderne. La combinaison exceptionnelle de propriétés réfractaires, de versatilité chimique et de valeur économique liée à sa rareté en fait un élément critique pour les applications technologiques avancées nécessitant des conditions extrêmes. Les recherches actuelles visent la durabilité par l'amélioration de l'efficacité du recyclage, la réduction de la teneur en rhénium dans les catalyseurs et l'exploration de stratégies de substitution pour les applications aérospatiales. Les développements futurs pourraient inclure l'expansion des applications en médecine nucléaire exploitant les propriétés des isotopes radioactifs et de nouveaux matériaux à haute température tirant parti de la stabilité thermique sans égale du rhénium.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
