| Élément | |
|---|---|
44RuRuthénium101.0722
8 18 15 1 |
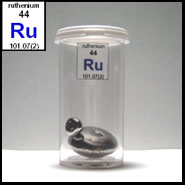
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 44 |
| Masse atomique | 101.072 amu |
| Famille d'éléments | Les métaux de transition |
| Période | 5 |
| Groupe | 1 |
| Bloc | s-block |
| Année découverte | 1844 |
| Distribution des isotopes |
|---|
96Ru 5.52% 98Ru 1.88% 99Ru 12.7% 100Ru 12.6% 101Ru 17.0% 102Ru 31.6% 104Ru 18.7% |
96Ru (5.52%) 98Ru (1.88%) 99Ru (12.70%) 100Ru (12.60%) 101Ru (17.00%) 102Ru (31.60%) 104Ru (18.70%) |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 12.37 g/cm3 (STP) |
H (H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 2250 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 3900 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | +3, +4 (-2, 0, +1, +2, +5, +6, +7, +8) |
| Potentiel de première ionisation | 7.361 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | 1.046 eV |
Nobelium (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 2.2 |
Césium (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |
| Rayon atomique | |
|---|---|
| Rayon covalent | 1.25 Å |
H (H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |
| Rayon métallique | 1.34 Å |
Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |
| Composés | ||
|---|---|---|
| Formule | Nom | État d'oxydation |
| C43H72Cl2P2Ru | Catalyseur Grubbs | +2 |
| RuCl2 | Chlorure de ruthénium(II) | +2 |
| Ru(NO3)3 | Nitrate de ruthénium(III) | +3 |
| RuBr3 | Bromure de ruthénium(III) | +3 |
| RuI3 | Iodure de ruthénium(III) | +3 |
| BaRuO3 | Ruthénate de baryum | +4 |
| Li2RuO3 | Ruthénate de lithium | +4 |
| RuCl4 | Tétrachlorure de ruthénium | +4 |
| RuF4 | Fluorure de ruthénium(IV) | +4 |
| RuO2 | Oxyde de ruthénium(IV) | +4 |
| RuF6 | Hexafluorure de ruthénium | +6 |
| RuO4 | Oxyde de ruthénium (VIII) | +8 |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 18, 15, 1 |
| Configuration électronique | [Kr] 4d7 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 8 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Ruthénium (Ru) : Élément du Tableau Périodique
Résumé
Le ruthénium est un élément métallique de transition rare possédant le numéro atomique 44 et le symbole chimique Ru. Il appartient aux métaux du groupe du platine du groupe 8 du tableau périodique. Ce métal dur, brillant et blanc-argenté présente une inertie chimique exceptionnelle dans des conditions ambiantes et une résistance remarquable à la corrosion et à l'oxydation. Il possède la configuration électronique [Kr] 4d7 5s1 et montre des états d'oxydation allant de −2 à +8, les états +2, +3 et +4 étant les plus courants. L'élément affiche des propriétés physiques uniques, notamment un point de fusion de 2607 K, un point d'ébullition de 4423 K et une densité de 12,45 g/cm³. Ses applications industrielles incluent les contacts électriques, les résistances à couche épaisse et les procédés catalytiques. La production mondiale annuelle est d'environ 35 tonnes, les gisements sud-africains et russes constituant les principales sources commerciales.
Introduction
Le ruthénium occupe la position 44 dans le tableau périodique, situé dans la deuxième rangée des métaux de transition du groupe 8. L'élément présente une configuration électronique anormale [Kr] 4d7 5s1, s'écartant du motif attendu d6s2 observé chez le fer voisin. Cette configuration résulte de l'énergie de stabilisation associée aux sous-couches d demi-pleines et contribue aux propriétés chimiques distinctes du ruthénium. Karl Ernst Claus a découvert le ruthénium en 1844 en analysant des résidus de minerai de platine à l'Université de Kazan, nommant l'élément d'après Ruthenia, la dénomination latine historique de la Russie. Cette découverte a marqué un progrès significatif en chimie des métaux du groupe du platine et a établi le ruthénium comme le dernier membre du trio léger du groupe, aux côtés du rhodium et du palladium.
Propriétés Physiques et Structure Atomique
Paramètres Atomiques Fondamentaux
Le ruthénium possède le numéro atomique 44 et une masse atomique de 101,07 u. Sa structure électronique suit la configuration [Kr] 4d7 5s1, présentant une anomalie au sein des éléments du groupe 8 où l'orbitale 5s contient un seul électron au lieu de deux. Cette disposition résulte de la stabilisation par l'énergie d'échange au sein de la configuration d7. Le rayon atomique mesure 134 pm, tandis que les rayons ioniques varient selon l'état d'oxydation : Ru3+ présente un rayon de 68 pm et Ru4+ un rayon de 62 pm. La charge nucléaire effective ressentie par les électrons de valence est d'environ 4,1, modérée par les effets d'écran des couches internes. L'énergie de première ionisation est de 710,2 kJ/mol, la deuxième ionisation mesure 1620 kJ/mol, et la troisième ionisation atteint 2747 kJ/mol, reflétant l'augmentation progressive de l'attraction nucléaire lors de l'élimination des électrons.
Caractéristiques Physiques Macroscopiques
Le ruthénium se manifeste comme un métal brillant, dur et blanc-argenté possédant une durabilité mécanique remarquable. L'élément cristallise dans une structure hexagonale compacte avec des paramètres de réseau a = 270,6 pm et c = 428,1 pm dans des conditions ambiantes. Quatre modifications polymorphiques existent, la phase hexagonale restant stable sous pression et température normales. La densité est de 12,45 g/cm³ à 298 K, plaçant le ruthénium parmi les éléments les plus denses. Le point de fusion atteint 2607 K (2334°C), tandis que le point d'ébullition est de 4423 K (4150°C). L'enthalpie de fusion est de 38,59 kJ/mol, l'enthalpie de vaporisation est de 591,6 kJ/mol, et la capacité thermique molaire à pression constante est de 24,06 J/(mol·K). La conductivité thermique est de 117 W/(m·K) à température ambiante, tandis que la résistivité électrique est de 7,1 × 10−8 Ω·m.
Propriétés Chimiques et Réactivité
Structure Électronique et Comportement de Liaison
La configuration de valence d7s1 du ruthénium permet des états d'oxydation de −2 à +8, bien que les états +2, +3 et +4 soient prédominants dans les composés stables. L'élément présente des géométries de coordination variables, incluant octaédrique, tétraédrique et plan carré, selon la force du champ ligand et l'état d'oxydation. La formation des liaisons implique principalement l'hybridation des orbitales d, avec une capacité de liaison π notable issue des orbitales d pleines ou partiellement remplies. Les longueurs moyennes des liaisons Ru−O varient de 197 pm dans RuO4 à 205 pm dans RuO2, tandis que les liaisons Ru−Cl mesurent généralement 235-245 pm. L'élément démontre une forte affinité pour les ligands π-accepteurs tels que le monoxyde de carbone et les phosphines, formant des complexes de coordination stables via des mécanismes synergiques de σ-donation et π-rétrodonation.
Propriétés Électrochimiques et Thermodynamiques
Le ruthénium présente des valeurs d'électronégativité de 2,2 sur l'échelle de Pauling et 4,5 eV sur celle de Mulliken, indiquant une capacité modérée d'attraction électronique. Les potentiels électrodes standards en solution aqueuse acide montrent la versatilité redox de l'élément : le couple Ru3+/Ru2+ présente un potentiel de +0,249 V, tandis que RuO42−/Ru2+ atteint +1,563 V, démontrant une puissante capacité oxydante des états d'oxydation élevés. L'affinité électronique est de 101,3 kJ/mol, reflétant une tendance modérée à accepter des électrons. L'analyse thermodynamique révèle que les composés du ruthénium présentent généralement des enthalpies de formation négatives, RuO2 montrant ΔHf° = −305,0 kJ/mol. L'élément démontre une stabilité exceptionnelle face à la corrosion atmosphérique, restant inerte vis-à-vis de l'oxygène, de l'eau et de la plupart des acides à température ambiante. L'oxydation commence uniquement au-delà de 1073 K, formant le RuO4 volatil.
Composés Chimiques et Formation de Complexes
Composés Binaires et Ternaires
Le ruthénium forme divers oxydes couvrant plusieurs états d'oxydation. Le dioxyde de ruthénium (RuO2) est l'oxyde le plus stable thermodynamiquement, cristallisant dans la structure rutile avec une symétrie tétragonale. Ce composé présente une conductivité métallique et une activité catalytique pour les réactions d'évolution de l'oxygène. Le tétraoxyde de ruthénium (RuO4) est un solide jaune volatil fondant à 298 K, démontrant des propriétés oxydantes comparables à celles du tétraoxyde d'osmium. La formation d'halogénures englobe tous les halogènes usuels : le hexafluorure de ruthénium (RuF6) est un solide brun foncé à géométrie moléculaire octaédrique, tandis que le trichlorure de ruthénium (RuCl3) existe sous forme de cristaux polymériques rouge-brun. Les chalcogénures incluent le disulfure de ruthénium (RuS2) adoptant la structure de la pyrite et le diséléniure de ruthénium (RuSe2) avec une disposition cristallographique similaire.
Chimie de Coordination et Composés Organométalliques
Le ruthénium montre une chimie de coordination étendue avec divers ligands. Les complexes pentaammine [Ru(NH3)5L]n+ présentent une géométrie octaédrique avec un sixième site de coordination occupé par des ligands variables. Les complexes polypyridyles, comme [Ru(bpy)3]2+, affichent des propriétés luminescentes et de transfert électronique. Les composés organométalliques incluent le ruthénocène (Ru(C5H5)2) à structure sandwich et les agrégats carbonylés tels que Ru3(CO)12. Les complexes de carbenes, notamment les catalyseurs de Grubbs contenant des doubles liaisons ruthénium-carbone, permettent des réactions de métathèse d'oléfines avec une sélectivité élevée et une tolérance aux groupes fonctionnels. Les espèces ligandées par les phosphines comme RuCl2(PPh3)3 servent de précurseurs synthétiques polyvalents pour divers complexes de ruthénium.
Occurrence Naturelle et Analyse Isotopique
Distribution Géochimique et Abondance
Le ruthénium présente une abondance crustale extrêmement faible, environ 0,001 ppm (1 ppb), se classant 78e élément le plus abondant. Il se trouve principalement dans les roches ignées ultramafiques et les gisements de métaux du groupe du platine des intrusions stratifiées. Les principaux gisements sont localisés dans le Complexe de Bushveld en Afrique du Sud, contenant environ 95 % des réserves mondiales, et dans la région de Norilsk-Talnakh en Russie. Des gisements plus petits mais économiquement significatifs existent dans le bassin de Sudbury en Ontario, Canada, au sein de minerais sulfurés. La fraction géochimique durant les processus magmatiques concentre le ruthénium avec les autres métaux du groupe du platine par immiscibilité des liquides sulfurés. L'élément montre un comportement sidérophile, se concentrant préférentiellement dans les phases métalliques lors des processus de différenciation planétaire.
Propriétés Nucléaires et Composition Isotopique
Le ruthénium naturel comprend sept isotopes stables : 96Ru (5,54 %), 98Ru (1,87 %), 99Ru (12,76 %), 100Ru (12,60 %), 101Ru (17,06 %), 102Ru (31,55 %) et 104Ru (18,62 %). L'isotope 102Ru possède un spin nucléaire nul, tandis que les autres présentent divers spins contribuant aux applications en spectroscopie RMN. Les moments magnétiques nucléaires varient de −0,6413 magnéton nucléaire pour 99Ru à +0,2875 pour 101Ru. Trente-quatre isotopes radioactifs ont été caractérisés, 106Ru possédant la demi-vie la plus longue de 373,59 jours. Cet isotope subit une désintégration bêta vers 106Rh et est utilisé en radiothérapie médicale. Les masses atomiques des isotopes connus s'étendent de 90 à 115, avec des sections efficaces neutroniques thermiques variables : 104Ru présente 0,31 barns tandis que 105Ru atteint 1200 barns.
Production Industrielle et Applications Technologiques
Méthodologies d'Extraction et de Purification
L'extraction du ruthénium se produit en tant que sous-produit de la récupération des métaux du groupe du platine lors des opérations de raffinage du cuivre et du nickel. La matière première principale consiste en précipités de boue anodique issus des processus d'électroraffinage, contenant 0,5 à 2 % de ruthénium en masse. La séparation initiale utilise une fusion à la peroxyde de sodium à 873 K, suivie d'une dissolution par l'eau régale pour solubiliser les métaux précieux. Le ruthénium reste insoluble avec l'osmium et l'iridium, permettant une séparation préliminaire par précipitation. Un traitement ultérieur avec du bisulfate de sodium à 723 K dissout le ruthénium tout en laissant l'osmium et l'iridium indissous. L'oxydation en RuO4 volatil permet une purification par distillation, avec une efficacité de collecte supérieure à 95 %. La réduction finale utilise l'hydrogène gazeux à 773 K, produisant une poudre de ruthénium métallique d'une pureté proche de 99,9 %. La production mondiale annuelle est estimée à environ 35 tonnes, l'Afrique du Sud fournissant environ 85 % de la production totale.
Applications Technologiques et Perspectives Futures
Les applications électriques constituent l'usage industriel principal du ruthénium, consommant environ 45 % de la production annuelle. Les contacts électriques exploitent la résistance à l'usure et à l'oxydation du ruthénium, particulièrement dans les dispositifs de commutation fonctionnant à haute densité de courant. Les résistances à couche épaisse incorporent du dioxyde de ruthénium avec des ruthénates de plomb et de bismuth, fournissant des valeurs de résistance stables sur une large plage de température. Les applications catalytiques incluent la synthèse Fischer-Tropsch, où les catalyseurs au cobalt dopés au ruthénium montrent une sélectivité supérieure pour les hydrocarbures linéaires. Les catalyseurs de métathèse d'oléfines, notamment les catalyseurs de Grubbs, permettent la synthèse pharmaceutique et la production de polymères avec une efficacité exceptionnelle. Les applications émergentes incluent les supports de stockage de données, où les films de ruthénium assurent le couplage magnétique dans les structures multicouches, et les matériaux de stockage d'hydrogène via la formation d'hydrures métalliques. Les perspectives futures concernent les électrodes de piles à combustible, les matériaux de supercondensateurs et les dispositifs mémoire avancés exploitant les propriétés électroniques du ruthénium.
Développement Historique et Découverte
La découverte du ruthénium provient de l'analyse systématique des résidus de minerai de platine durant l'expansion de la chimie du platine au début du XIXe siècle. Gottfried Osann a prétendu en 1828 avoir découvert l'élément en examinant des minerais de platine des monts Oural, proposant trois nouveaux éléments incluant le ruthénium. Cependant, Jöns Jakob Berzelius a contesté ces résultats, déclenchant une longue controverse scientifique sur la composition des résidus. Karl Ernst Claus a résolu ce débat en 1844 par l'isolement et la caractérisation définitifs à l'Université de Kazan. Claus a obtenu 6 grammes de ruthénium à partir de minerai de platine insoluble dans l'eau régale, établissant l'identité distincte de l'élément par analyse chimique systématique. Le nom de l'élément rend hommage à la Russie via la dénomination latine Ruthenia, reflétant son lieu de découverte dans l'Empire russe. En 1905, Theodore William Richards a déterminé précisément la masse atomique, tandis qu'en 1913, Henry Moseley a confirmé le numéro atomique 44 par spectroscopie X. Les applications industrielles modernes se sont développées après les avancées en technologie des contacts électriques et de la catalyse durant la Seconde Guerre mondiale.
Conclusion
Le ruthénium représente un membre unique des métaux du groupe du platine, distingué par sa stabilité chimique exceptionnelle, sa chimie d'oxydation variée et ses applications technologiques spécialisées. Sa configuration électronique anormale contribue à des propriétés de liaison et de catalyse distinctes, alimentant continuellement l'innovation industrielle. Les applications actuelles en électronique, catalyse et technologies émergentes démontrent le rôle critique du ruthénium en science des matériaux avancés. Les recherches futures portent sur la catalyse atomique unique, les applications en informatique quantique et les technologies énergétiques durables, où les propriétés uniques du ruthénium offrent des avantages significatifs. Sa rareté et sa distribution géographique concentrée soulignent l'importance des technologies de recyclage et du développement de matériaux alternatifs. La compréhension de la chimie fondamentale du ruthénium reste essentielle pour optimiser les applications existantes et développer les technologies de nouvelle génération nécessitant des performances chimiques et physiques supérieures.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
