| Élément | |
|---|---|
24CrChrome51.996162
8 13 1 |
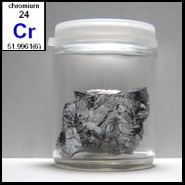
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 24 |
| Masse atomique | 51.99616 amu |
| Famille d'éléments | Les métaux de transition |
| Période | 4 |
| Groupe | 1 |
| Bloc | s-block |
| Année découverte | 1794 |
| Distribution des isotopes |
|---|
52Cr 83.79% 53Cr 9.50% 54Cr 2.36% |
52Cr (87.60%) 53Cr (9.93%) 54Cr (2.47%) |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 7.15 g/cm3 (STP) |
(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 1857 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 2482 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | +3, +6 (-4, -2, -1, 0, +1, +2, +4, +5) |
| Potentiel de première ionisation | 6.767 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | 0.676 eV |
Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 1.66 |
Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |
| Rayon atomique | |
|---|---|
| Rayon covalent | 1.22 Å |
(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |
| Rayon métallique | 1.28 Å |
Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |
| Composés | ||
|---|---|---|
| Formule | Nom | État d'oxydation |
| CrH | Hydrure de chrome (I) | +1 |
| CrCl2 | Chlorure de chrome(II) | +2 |
| Cr(CH3CO2)2 | Acétate de chrome (II) | +2 |
| Cr3C2 | Carbure de chrome(II) | +2 |
| Cr2O3 | Oxyde de chrome (III) | +3 |
| CrCl3 | Chlorure de chrome(III) | +3 |
| CrPO4 | Phosphate de chrome (III) | +3 |
| CrO2 | Oxyde de chrome (IV) | +4 |
| CrCl4 | Chlorure de chrome (IV) | +4 |
| CrF5 | Pentafluorure de chrome | +5 |
| K2Cr2O7 | Dichromate de potassium | +6 |
| K2CrO4 | Chromate de potassium | +6 |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 13, 1 |
| Configuration électronique | [Ar] 3d5 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 6 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Chrome (Cr) : Élément du tableau périodique
Résumé
Le chrome présente des propriétés exceptionnelles qui en font un élément essentiel dans la métallurgie et la chimie modernes. Ce métal de transition gris acier démontre un comportement antiferromagnétique unique à température ambiante, une résistance remarquable à la corrosion par passivation spontanée, et une dureté extrême classée troisième après le diamant et le bore. Sa configuration électronique distinctive [Ar] 3d⁵ 4s¹ viole le principe d'Aufbau, contribuant à ses caractéristiques magnétiques et optiques inhabituelles. L'élément se manifeste principalement en états d'oxydation +3 et +6, formant des composés intensément colorés qui ont inspiré son étymologie grecque signifiant "couleur". Les applications industrielles se concentrent sur la production d'acier inoxydable et le chromage décoratif, représentant ensemble 85 % de son utilisation commerciale. Ses propriétés de réflectivité élevée, atteignant 90 % dans les longueurs d'onde infrarouges, combinées à une excellente résistance à la corrosion, rendent le chrome indispensable dans les technologies de revêtements protecteurs et les applications optiques.
Introduction
Le chrome occupe la position 24 du tableau périodique en tant que premier élément du groupe 6, distingué par une combinaison exceptionnelle de propriétés mécaniques, optiques et chimiques. Sa structure électronique [Ar] 3d⁵ 4s¹ représente la première déviation du principe d'Aufbau dans la série des métaux de transition, établissant des différences fondamentales dans ses caractéristiques de liaison par rapport aux éléments précédents. Cette configuration unique contribue directement à la résistance remarquable du chrome à l'oxydation et à son comportement magnétique distinctif. L'isolation du chrome métallique par Louis Nicolas Vauquelin en 1797 à partir de minerai de crocoïte a marqué le début de l'étude systématique de ses propriétés et applications. Les connaissances modernes révèlent son rôle critique dans les avancées métallurgiques, notamment le développement des aciers inoxydables qui ont révolutionné la résistance industrielle à la corrosion. Son importance s'étend à des technologies avancées incluant les supports magnétiques haute performance, les revêtements optiques précis et des processus chimiques spécialisés où ses propriétés sont irremplaçables.
Propriétés physiques et structure atomique
Paramètres atomiques fondamentaux
La structure atomique du chrome repose sur 24 protons et une masse atomique de 51,9961 ± 0,0006 u. La configuration électronique [Ar] 3d⁵ 4s¹ s'écarte de la séquence attendue [Ar] 3d⁴ 4s², reflétant une stabilité accrue grâce à l'occupation semi-remplie des orbitales d. Cette configuration engendre une arrangement d⁵ particulièrement stable influençant son comportement chimique à travers plusieurs états d'oxydation. Son rayon atomique mesure environ 128 pm, les rayons ioniques variant significativement selon l'état d'oxydation et l'environnement de coordination. À l'état +3, le chrome présente un rayon ionique de 62 pm en coordination octaédrique, tandis que l'état +6 montre un caractère ionique réduit dû à des liaisons covalentes étendues. La charge nucléaire effective subie par les électrons de valence augmente progressivement dans la première série de transition, le chrome démontrant une attraction nucléaire renforcée expliquant sa structure atomique compacte et ses énergies d'ionisation élevées.
Caractéristiques physiques macroscopiques
Le chrome cristallise dans une structure cubique centrée avec un paramètre de réseau a = 2,885 Å à température ambiante. Il apparaît comme un métal gris acier brillant, caractérisé par une dureté exceptionnelle proche de celle de certaines céramiques. Sa dureté de 8,5 sur l'échelle de Mohs le place parmi les métaux les plus durs, surpassé uniquement par le diamant et le bore parmi les éléments purs. Les mesures de dureté Vickers donnent 950 HV, confirmant sa résistance à la déformation plastique. Son point de fusion à 1907 °C fait du chrome le deuxième élément de la période 4 avec la température de fusion la plus élevée, juste après le vanadium de 3 °C. Le point d'ébullition à 2671 °C reflète une liaison métallique relativement faible comparée aux premiers métaux de transition, attribuable au début de la localisation des électrons d. Sa densité de 7,19 g/cm³ est cohérente avec l'augmentation progressive dans la première série de transition. Sa résistivité électrique de 125 nΩ·m à 20 °C indique une conductivité modérée influencée par sa structure magnétique et le comportement des électrons d.
Propriétés chimiques et réactivité
Structure électronique et comportement de liaison
La configuration d⁵ du chrome crée des motifs de liaison distinctifs avec des géométries de coordination variables et plusieurs états d'oxydation accessibles. Le chrome forme volontairement des complexes octaédriques à l'état +3, utilisant une hybridation d²sp³ qui permet l'arrangement stable de six ligands. À l'état +6, des liaisons π étendues via le recouvrement des orbitales d avec l'oxygène conduisent à une coordination tétraédrique dans les oxoanions comme le chromate (CrO₄²⁻) et le dichromate (Cr₂O₇²⁻). Les longueurs de liaison varient systématiquement avec l'état d'oxydation : les liaisons Cr-O vont de 1,99 Å dans Cr₂O₃ à 1,65 Å dans CrO₃, reflétant une attraction électrostatique accrue avec les charges formelles élevées. L'état +2 montre une liaison quadruple Cr-Cr inhabituelle dans des composés comme l'acétate de chrome(II), où la distance de 2,36 Å constitue l'une des plus courtes connues entre atomes métalliques. Les nombres de coordination s'étendent de 4 à 9, la géométrie octaédrique à coordination 6 prédominant en chimie aqueuse.
Propriétés électrochimiques et thermodynamiques
Le comportement électrochimique du chrome reflète les relations de stabilité entre ses états d'oxydation. Le potentiel de réduction standard Cr³⁺/Cr vaut -0,744 V, indiquant un caractère réducteur modéré du métal. Le couple Cr₂O₇²⁻/Cr³⁺ présente un potentiel de +1,33 V en milieu acide, établissant le dichromate comme un oxydant puissant utilisé en chimie analytique. Les énergies d'ionisation successives montrent la stabilisation progressive des électrons d : première ionisation à 653,9 kJ/mol, seconde à 1590,6 kJ/mol, troisième à 2987 kJ/mol et quatrième à 4743 kJ/mol. L'augmentation dramatique entre la troisième et quatrième ionisation reflète l'extraction d'électrons depuis la configuration stable d³. L'électronégativité sur l'échelle de Pauling mesure 1,66, plaçant le chrome comme modérément électronégatif parmi les métaux de transition. Les données thermodynamiques montrent un Cr₂O₃ particulièrement stable avec une enthalpie de formation de -1139,7 kJ/mol, expliquant sa résistance exceptionnelle à la corrosion via la passivation oxydante.
Composés chimiques et formation de complexes
Composés binaires et ternaires
Le chrome forme une vaste série de composés binaires couvrant tous les états d'oxydation accessibles, avec des stabilités thermodynamiques variables. L'oxyde de chrome(III) Cr₂O₃, le composé binaire le plus stable, cristallise dans la structure du corindon avec une résistance exceptionnelle à la réduction et à la décomposition thermique. Ce composé conserve son intégrité structurelle au-delà de 2000 °C et démontre une inertie chimique remarquable dans les environnements acides et basiques. Son enthalpie de formation (-1139,7 kJ/mol) en fait l'un des oxydes métalliques les plus favorables thermodynamiquement. L'oxyde de chrome(VI) CrO₃ présente des propriétés contrastées en tant qu'oxydant puissant se décomposant au-delà de 196 °C pour libérer du dioxygène. Les halogénures démontrent des tendances systématiques : CrF₆ n'existe que dans des conditions spéciales à cause de l'oxydation forte du fluor, tandis que CrCl₃ forme des cristaux violets stables à structure en couches. Les sulfures incluent CrS avec des propriétés métalliques et Cr₂S₃ montrant un comportement semi-conducteur.
Chimie de coordination et composés organométalliques
Les complexes du chrome démontrent une diversité remarquable de structures, liaisons et réactivités reflétant ses états d'oxydation variables et configurations d'électrons d. Les complexes hexacoordonnés de Cr(III) dominent en milieu aqueux, la géométrie octaédrique maximisant l'énergie de stabilisation du champ cristallin pour la configuration d³. L'ion aquahexachrome(III) [Cr(H₂O)₆]³⁺ subit des échanges de ligands lents avec des demi-vies de plusieurs heures à jours, permettant des études cinétiques détaillées. Les complexes d'amine comme [Cr(NH₃)₆]³⁺ montrent une stabilité cinétique accrue et servent de précurseurs synthétiques. Les ligands polydentates forment des complexes particulièrement stables : le complexe [Cr(EDTA)]⁻ possède des constantes de formation supérieures à 10²³ M⁻¹, reflétant les effets chélatants et l'adéquation entre la taille du ligand et celle de l'ion. La chimie organométallique du chrome se concentre sur des espèces de bas état d'oxydation avec des interactions π étendues. Le bis(benzène)chrome illustre un composé sandwich classique où les cycles aromatiques se coordonnent par donation π équilibrée par rétro-donation métallique. L'hexacarbonyle de chrome Cr(CO)₆ subit des réactions de substitution photochimiques par dissociation initiale du CO suivie d'addition coordinative, permettant l'accès à des complexes mixtes.
Occurrence naturelle et analyse isotopique
Distribution géochimique et abondance
Le chrome occupe la 21e place en abondance dans la croûte terrestre avec une concentration moyenne de 100-300 ppm en masse. Son comportement géochimique reflète son affinité forte pour l'oxygène et sa tendance à substituer l'aluminium dans des sites de coordination octaédriques des minéraux silicatés. Les minerais principaux incluent la chromite FeCr₂O₄, source de presque toute l'extraction commerciale. Ce minéral spinelle démontre une stabilité chimique et thermique exceptionnelle, persistant à travers l'érosion et les processus métamorphiques. Les mécanismes de concentration opèrent par différenciation magmatique, où la chromite cristallise précocement à partir de magmas mafiques et ultramafiques. Les plus grands gisements économiques se trouvent dans le Complexe du Bushveld en Afrique du Sud, détenant environ 70 % des réserves mondiales. Les dépôts podiformes se forment par des mécanismes différents impliquant la séricitisation et les processus métamorphiques dans les complexes ophiolitiques. Les concentrations sédimentaires restent généralement faibles à cause de la mobilité limitée du chrome, bien que certains placers contiennent des concentrations économiquement exploitables.
Propriétés nucléaires et composition isotopique
Le chrome naturel contient quatre isotopes stables avec des abondances précisément déterminées. L'isotope dominant ⁵²Cr représente 83,789 % du chrome naturel, suivi de ⁵³Cr à 9,501 %, ⁵⁰Cr à 4,345 % et ⁵⁴Cr à 2,365 %. L'isotope ⁵⁰Cr montre une stabilité observée malgré sa capacité théorique à subir une désintégration par capture électronique double vers ⁵⁰Ti avec une demi-vie supérieure à 1,3 × 10¹⁸ ans. Les spins nucléaires varient : ⁵⁰Cr et ⁵²Cr ont un spin nul, tandis que ⁵³Cr possède un spin I = 3/2 avec un moment magnétique μ = -0,47454 magnéton nucléaire. Vingt-cinq radioisotopes sont caractérisés, ⁵¹Cr étant le plus significatif avec une demi-vie de 27,7 jours et son utilisation en traçage biologique. Cet isotope se transforme en ⁵¹V par capture électronique avec émission gamma à 320 keV. Les applications cosmochimiques exploitent le système de datation ⁵³Mn-⁵³Cr avec une demi-vie de 3,74 millions d'années pour dater l'histoire précoce du Système Solaire. Les sections efficaces de capture neutronique montrent que ⁵⁰Cr est l'isotope le plus réactif aux neutrons thermiques, facilitant diverses applications en chimie nucléaire.
Production industrielle et applications technologiques
Méthodes d'extraction et de purification
La production industrielle du chrome commence par le traitement du minerai de chromite via des opérations métallurgiques à haute température approchant 1700 °C. Le procédé dominant utilise la réduction carbothermique de la chromite dans des fours à arc électrique selon la réaction : FeCr₂O₄ + 4C → Fe + 2Cr + 4CO, produisant des alliages ferrochrome avec 50-70 % de chrome en masse. L'efficacité de ce procédé atteint 85-90 % de récupération du chrome, avec une consommation énergétique de 3000-4000 kWh par tonne d'alliage. Les minerais de bas grade subissent une concentration par séparation gravimétrique et magnétique. La production du chrome métallique pur nécessite des opérations supplémentaires incluant le grillage et la lixiviation pour séparer le chrome du fer, puis l'électrowinning à partir d'acide chromique à des densités de courant de 20-50 A/dm².
Applications technologiques et perspectives futures
La fabrication d'acier inoxydable représente l'application principale du chrome, consommant environ 70 % de sa production mondiale par ajout de ferrochrome conférant résistance à la corrosion et propriétés mécaniques. Les aciers inoxydables austénitiques contiennent typiquement 16-26 % de chrome avec 8-35 % de nickel, tandis que les nuances ferritiques utilisent 10,5-27 % de chrome sans nickel significatif. La couche d'oxyde riche en chrome se forme spontanément en environnement oxydant, créant une barrière autoreparatrice maintenant son intégrité après dommages mécaniques et exposition chimique. Le chromage dur applique des dépôts de 25-500 μm pour des applications résistantes à l'usure comme les vérins hydrauliques, outils de machine et composants moteur. Le chromage décoratif utilise des dépôts plus minces de 0,25-0,50 μm sur cuivre ou nickel, offrant des finitions brillantes avec une grande durabilité. Les applications optiques avancées exploitent les propriétés sélectives de réflectivité du chrome dans des revêtements interférentiels et miroirs laser où le contrôle précis de l'épaisseur permet des caractéristiques spectrales spécifiques. Les milieux magnétiques à base de dioxyde de chrome démontrent une coercivité et rémanence supérieures comparées aux formulations classiques d'oxyde de fer, bien que leur utilisation ait décliné avec l'essor du stockage numérique. Les applications émergentes incluent des superalliages au chrome pour l'aérospatiale où la résistance à l'oxydation à haute température est critique, et des systèmes catalytiques spécialisés utilisant les états d'oxydation multiples pour des transformations organiques sélectives.
Développement historique et découverte
La reconnaissance scientifique du chrome a évolué à travers des études minéralogiques minutieuses sur plusieurs décennies à la fin du XVIIIe siècle. Johann Gottlob Lehmann a décrit en 1761 des échantillons rouges sibériens (crocoïte PbCrO₄), les premiers documents scientifiques sur les composés de chrome. Louis Nicolas Vauquelin a isolé le chrome métallique en 1797 par réduction du trioxyde de chrome avec du charbon, confirmant l'existence d'un élément inconnu. Le nom "chrome" dérive du mot grec χρῶμα (chrōma) signifiant "couleur", en référence aux teintes vives des composés à différents états d'oxydation. Les applications industrielles ont rapidement suivi la découverte de gisements de chromite à Baltimore en 1827. La compréhension de sa résistance à la corrosion a progressé avec les études systématiques de Harry Brearley au début du XXe siècle, menant au développement des aciers inoxydables transformant la métallurgie. Le chromage électrolytique s'est développé dans les années 1920, exploité pour son apparence décorative et ses qualités protectrices. Les applications modernes incluent les alliages haute température, revêtements optiques spécialisés et processus chimiques de précision élargissant continuellement sa pertinence technologique.
Conclusion
Le chrome conserve une position unique parmi les métaux de transition grâce à la combinaison exceptionnelle de ses propriétés mécaniques, chimiques et optiques découlant de sa configuration électronique d⁵ distinctive. Sa violation du principe d'Aufbau crée des relations de stabilité permettant plusieurs états d'oxydation accessibles et une résistance extraordinaire à la corrosion par passivation. Son importance industrielle repose sur la production d'acier inoxydable et les revêtements protecteurs exploitant sa résistance fondamentale à la dégradation environnementale. Les technologies émergentes reconnaissent de plus en plus son potentiel dans les matériaux avancés incluant les alliages haute température, systèmes optiques précis et processus catalytiques spécialisés. Les recherches futures exploreront des méthodes durables d'extraction, des compositions alliées novatrices pour environnements extrêmes et des nanomatériaux au chrome utilisant ses caractéristiques magnétiques et optiques uniques. L'expansion continue de ses applications reflète une appréciation croissante de son rôle irremplaçable dans les technologies exigeant une durabilité exceptionnelle, résistance à la corrosion et performances optiques élevées.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
