| Élément | |
|---|---|
28NiNickel58.693422
8 16 2 |
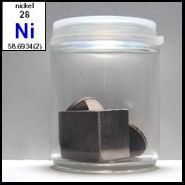
|
| Propriétés de base | |
|---|---|
| Numéro atomique | 28 |
| Masse atomique | 58.69342 amu |
| Famille d'éléments | Les métaux de transition |
| Période | 4 |
| Groupe | 2 |
| Bloc | s-block |
| Année découverte | 1751 |
| Distribution des isotopes |
|---|
58Ni 68.27% 60Ni 26.10% 61Ni 1.13% 62Ni 3.59% 64Ni 0.91% |
58Ni (68.27%) 60Ni (26.10%) 61Ni (1.13%) 62Ni (3.59%) 64Ni (0.91%) |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 8.912 g/cm3 (STP) |
(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |
| Fusion | 1453 °C |
Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |
| Ébullition | 2732 °C |
Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |
| Propriétés chimiques | |
|---|---|
| États d'oxydation (moins courant) | +2 (-2, -1, 0, +1, +3, +4) |
| Potentiel de première ionisation | 7.639 eV |
Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |
| Affinité électronique | 1.157 eV |
Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |
| Électronégativité | 1.91 |
Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |
| Rayon atomique | |
|---|---|
| Rayon covalent | 1.1 Å |
(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |
| Van der Waals rayon | 1.63 Å |
(H) 1.2 Francium (Fr) 3.48 | |
| Rayon métallique | 1.24 Å |
Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |
| Composés | ||
|---|---|---|
| Formule | Nom | État d'oxydation |
| NiCl2 | Chlorure de nickel(II) | +2 |
| Ni(NO3)2 | Nitrate de nickel(II) | +2 |
| NiO | Oxyde de nickel(II) | +2 |
| Ni(OH)2 | Hydroxyde de nickel(II) | +2 |
| NiCO3 | Carbonate de nickel(II) | +2 |
| NiS | Sulfure de nickel(II) | +2 |
| Ni(CN)2 | Cyanure de nickel(II) | +2 |
| C24H46NiO4 | Laurate de nickel(II) | +2 |
| C36H70NiO4 | Stéarate de nickel(II) | +2 |
| Ni2O3 | Oxyde de nickel(III) | +3 |
| NiF3 | Fluorure de nickel(III) | +3 |
| K2NiF6 | Hexafluoronickélate de potassium (IV) | +4 |
| Propriétés électroniques | |
|---|---|
| Électrons par couche | 2, 8, 16, 2 |
| Configuration électronique | [Ar] 3d8 |
|
Modèle atomique de Bohr
| |
|
Diagramme de la boîte orbitale
| |
| électrons de valence | 10 |
| Structure de Lewis en points |
|
| Visualisation orbitale | |
|---|---|
|
| |
| Électrons | - |
Nickel (Ni) : Élément du Tableau Périodique
Résumé
Le nickel (Ni), de numéro atomique 28, est un métal de transition ferromagnétique caractérisé par une résistance exceptionnelle à la corrosion et des applications industrielles variées. Situé dans le groupe 10 du tableau périodique, le nickel présente une configuration électronique contestée, les recherches récentes soutenant [Ar] 3d⁹ 4s¹ plutôt que l'attribution traditionnelle des manuels scolaires [Ar] 3d⁸ 4s². L'élément démontre une remarquable versatilité en termes d'états d'oxydation allant de -2 à +4, bien que l'état +2 prédomine dans les composés chimiques. Le poids atomique du nickel, 58,6934 ± 0,0004 u, et ses cinq isotopes stables jouent un rôle important en géochimie terrestre et extraterrestre. Les applications industrielles incluent la production d'acier inoxydable, les alliages magnétiques, la catalyse et le plaquage électrolytique, tandis que ses fonctions biologiques comprennent des rôles essentiels dans les enzymes uréases et les complexes hydrogénases à travers plusieurs règnes du vivant.
Introduction
Le nickel occupe une position distinctive dans la série des métaux de transition de la première période, présentant des propriétés ferromagnétiques similaires à celles du fer, du cobalt et du gadolinium. Son importance dépasse les applications terrestres, les alliages fer-nickel constituant une part substantielle des matériaux météoritiques et des noyaux planétaires à travers le système solaire. Isolé pour la première fois par Axel Fredrik Cronstedt en 1751 à partir de minerai de kupfernickel, le nom de l'élément provient de l'allemand « Kupfernickel », littéralement « cuivre du diable », reflétant la frustration initiale des mineurs face à des minerais apparemment riches en cuivre mais produisant un métal inconnu. La controverse entourant la configuration électronique de l'état fondamental du nickel continue d'influencer les prédictions théoriques et les interprétations spectroscopiques, avec des preuves croissantes favorables à la configuration d⁹s¹ plutôt qu'aux attributions conventionnelles d⁸s².
Propriétés Physiques et Structure Atomique
Paramètres Atomiques Fondamentaux
La structure atomique du nickel comporte 28 électrons organisés autour d'un noyau contenant 28 protons et généralement 30 neutrons dans l'isotope le plus abondant, le ⁵⁸Ni. Le débat sur la configuration électronique porte sur le fait que l'état fondamental corresponde à [Ar] 3d⁸ 4s² ou [Ar] 3d⁹ 4s¹, les données spectroscopiques soutenant de plus en plus cette dernière disposition. Cette configuration influence les calculs des énergies d'ionisation, la première énergie d'ionisation mesurant 737,1 kJ mol⁻¹, reflétant la charge nucléaire relativement élevée et les effets de blindage électronique. Le rayon atomique du nickel mesure environ 124 pm, tandis que le rayon ionique du Ni²⁺ dans des environnements hexacoordonnés atteint 69 pm. Les calculs de charge nucléaire effective indiquent un blindage significatif des électrons 3d, influençant à la fois les schémas de réactivité chimique et les propriétés magnétiques via les interactions des électrons non appariés.
Caractéristiques Physiques Macroscopiques
Le nickel présente une apparence brillante argentée avec une légère teinte dorée sous un éclairage ambiant. Le métal cristallise dans une structure cubique à faces centrées (CFC) avec un paramètre de réseau a = 3,5238 Å à température ambiante. Cette arrangement compacte contribue aux propriétés mécaniques du nickel, notamment sa ductilité et sa malléabilité élevées, facilitant les procédés industriels de formage. Le ferromagnétisme se manifeste sous la température de Curie de 627 K (354°C), la magnétisation à saturation atteignant 0,616 T à température ambiante. La liaison métallique présente des caractéristiques typiques des métaux de transition, les électrons d délocalisés assurant une conductivité électrique d'environ 14,3 × 10⁶ S m⁻¹. La conductivité thermique mesure 90,9 W m⁻¹ K⁻¹, reflétant un transport phonique efficace à travers le réseau cristallin.
Propriétés Chimiques et Réactivité
Structure Électronique et Comportement de Liaison
Le comportement chimique du nickel découle de sa sous-couche 3d partiellement remplie, permettant des états d'oxydation variables et une chimie de coordination étendue. La configuration d⁹ (si acceptée comme état fondamental) crée un électron non apparié, expliquant le comportement paramagnétique de certains composés malgré le ferromagnétisme du métal massif. Les états d'oxydation +2, +3 et +4 sont les plus fréquents, le Ni²⁺ montrant une stabilité exceptionnelle en solution aqueuse et dans les complexes de coordination. La configuration d⁸ dans les complexes Ni²⁺ adopte souvent une géométrie plane carrée en raison des effets de stabilisation du champ cristallin, particulièrement visibles dans les complexes avec des ligands à champ fort comme le cyanure ou les phosphines. Les caractéristiques de liaison covalente apparaissent dans les composés organométalliques, où le nickel démontre des capacités de donneur σ et d'accepteur π par la participation des orbitales d.
Propriétés Électrochimiques et Thermodynamiques
Les valeurs d'électronégativité du nickel varient selon l'échelle utilisée, l'électronégativité de Pauling mesurant 1,91 et celle d'Allred-Rochow atteignant 1,75. Ces valeurs intermédiaires reflètent la position du nickel entre les éléments fortement électropositifs et les non-métaux électronégatifs, lui permettant de former à la fois des composés ioniques et covalents. Le potentiel électrode standard du couple Ni²⁺/Ni mesure -0,257 V par rapport à l'électrode d'hydrogène standard, indiquant la stabilité thermodynamique du métal en conditions acides. Les énergies successives d'ionisation suivent la tendance attendue : première (737,1 kJ mol⁻¹), seconde (1753 kJ mol⁻¹) et troisième (3395 kJ mol⁻¹), avec une augmentation significative entre la seconde et la troisième valeur confirmant l'état d'oxydation +2 préférentiel. Les données thermodynamiques des composés de nickel révèlent généralement des enthalpies de formation négatives pour les oxydes et les sulfures, indiquant une formation spontanée sous conditions appropriées.
Composés Chimiques et Formation de Complexes
Composés Binaires et Ternaires
Le nickel forme une vaste gamme de composés binaires avec pratiquement tous les éléments des groupes principaux. NiO représente l'oxyde le plus important, cristallisant dans la structure de type chlorure de sodium avec des cations Ni²⁺ occupant des sites octaédriques. Ce composé présente un ordonnancement antiferromagnétique sous 523 K et démontre des propriétés semi-conductrices avec un gap de bande d'environ 3,6 à 4,0 eV. Le sulfure NiS existe sous plusieurs formes polymorphes, incluant la millérite hexagonale et la heazlewoodite cubique, toutes deux importantes dans des contextes géologiques. Les composés halogénés comme NiCl₂, NiBr₂ et NiI₂ cristallisent en structures stratifiées et forment facilement des complexes hydratés par coordination avec des molécules d'eau. Les composés ternaires incluent les alliages Heusler technologiquement importants comme Ni₂MnGa, qui présente des propriétés de mémoire de forme et d'effet magnétocalorique.
Chimie de Coordination et Composés Organométalliques
Le nickel démontre une remarquable versatilité en chimie de coordination, formant des complexes avec des nombres de coordination allant de 2 à 6. L'ion Ni²⁺ adopte préférentiellement une géométrie plane carrée dans les complexes tétracoordonnés avec des ligands à champ fort, comme illustré par [Ni(CN)₄]²⁻, qui présente un comportement diamagnétique dû l'appariement complet des orbitales d. Les complexes octaédriques comme [Ni(H₂O)₆]²⁺ affichent des propriétés paramagnétiques avec deux électrons non appariés et une coloration verte caractéristique issue des transitions électroniques d-d. La chimie organométallique englobe de nombreux composés importants, incluant le nickelocène Ni(C₅H₅)₂ et le complexe bis(cyclooctadiène)nickel(0) industriellement significatif Ni(COD)₂. Les applications catalytiques exploitent la capacité des centres nickel à activer des molécules petites comme le monoxyde de carbone, l'hydrogène et les alcènes via des mécanismes d'addition oxydante et d'élimination réductrice.
Présence Naturelle et Analyse Isotopique
Distribution Géochimique et Abondance
L'abondance crustale du nickel est en moyenne d'environ 84 ppm, le plaçant au 22e rang des éléments les plus abondants dans la croûte terrestre. Cette distribution reste toutefois très hétérogène, avec des concentrations significatives dans les roches ultramafiques comme les péridotites et les dunites. Le bassin de Sudbury en Ontario, Canada, représente l'un des gisements de nickel les plus importants, formé par un impact météoritique il y a environ 1,85 milliard d'années. Cette structure d'impact a créé des conditions favorables à la séparation et à la concentration des mélanges sulfureux riches en nickel. D'autres gisements majeurs se trouvent dans le craton du Yilgarn en Australie-Occidentale, les minerais latéritiques de Nouvelle-Calédonie et la région de Norilsk en Russie. Le comportement géochimique lors des processus d'altération conduit à l'enrichissement en nickel des sols latéritiques en conditions tropicales, formant des dépôts économiques de garniérite et d'autres minéraux argileux riches en nickel.
Propriétés Nucléaires et Composition Isotopique
Le nickel naturel se compose de cinq isotopes stables : ⁵⁸Ni (68,077 %), ⁶⁰Ni (26,233 %), ⁶¹Ni (1,140 %), ⁶²Ni (3,635 %) et ⁶⁴Ni (0,926 %). Ces abondances isotopiques fournissent des empreintes digitales uniques pour le traçage des processus géochimiques et la classification des météorites. L'isotope le plus abondant, ⁵⁸Ni, possède un spin nucléaire I = 0, tandis que ⁶¹Ni présente I = 3/2 et sert de sonde importante pour les études de résonance magnétique nucléaire. Les isotopes radiogéniques incluent ⁵⁹Ni avec une demi-vie de 76 000 ans, produit par activation neutronique dans les réacteurs nucléaires et contribuant aux considérations sur les déchets radioactifs à long terme. L'isotope ⁶³Ni, avec une demi-vie de 100,1 ans, est utilisé dans le datation radiométrique et les études de traçage. Les sections efficaces nucléaires varient fortement entre les isotopes, ⁵⁸Ni montrant une absorption neutronique relativement faible comparé à ⁶⁰Ni et ⁶²Ni, influençant les calculs de conception des réacteurs et l'évolution isotopique sous irradiation neutronique.
Production Industrielle et Applications Technologiques
Extraction et Méthodes de Purification
La production primaire de nickel implique un traitement pyrométallurgique des minerais sulfurés, contenant généralement la pentlandite (Ni,Fe)₉S₈ comme minéral principal. Le processus commence par la concassage et la flottation pour concentrer les minerais sulfurés, suivis d'un grillage pour convertir les sulfures en oxydes et éliminer le soufre sous forme de SO₂. Le métallurgie suivante dans des fours à arc électrique produit une matte nickel-fer contenant 20 à 50 % de nickel et de fer combinés. Les opérations de conversion utilisant de l'air enrichi en oxygène oxydent préférentiellement le fer, concentrant le nickel dans la phase matte. La purification finale utilise le procédé Mond, où le monoxyde de carbone réagit avec le nickel métallique à 50-80°C pour former le composé volatil Ni(CO)₄, qui se décompose à 180-200°C pour déposer un métal nickel pur. Des méthodes hydrométallurgiques alternatives traitent les minerais latéritiques par lixiviation acide sous haute pression suivie d'une réduction par l'hydrogène, atteignant des puretés en nickel supérieures à 99,9 %.
Applications Technologiques et Perspectives Futures
La production d'acier inoxydable consomme environ 65 % de la production mondiale de nickel, où les additions de nickel (8 à 20 %) améliorent la résistance à la corrosion et les propriétés mécaniques par stabilisation de la phase austénitique. Les applications en superalliages dans les moteurs à réaction et les turbines à gaz industrielles exploitent la résistance élevée du nickel aux températures élevées et à l'oxydation, des compositions comme l'Inconel 718 contenant 50 à 55 % de nickel. La technologie des batteries utilise de plus en plus le nickel dans les cellules lithium-ion, particulièrement les cathodes NMC (nickel-manganèse-cobalt) où une teneur élevée en nickel améliore la densité énergétique. Les applications catalytiques couvrent les réactions d'hydrogénation en synthèse chimique, les procédés de reformage en raffinage pétrolier et les électrodes de piles à combustible pour l'oxydation de l'hydrogène. Les opérations de galvanoplastie déposent des revêtements décoratifs et fonctionnels en nickel, tandis que les techniques de métallurgie des poudres produisent des composants spécialisés à partir de poudres de nickel. Les applications émergentes incluent les alliages à mémoire magnétique pour les systèmes d'actuation et les alliages à haute entropie où le nickel contribue à la stabilité de phase et aux performances mécaniques.
Développement Historique et Découverte
Des preuves archéologiques indiquent une utilisation humaine des alliages fer-nickel météoritiques datant de 3500 av. J.-C., des artefacts des civilisations anciennes démontrant des techniques métallurgiques sophistiquées appliquées à des matériaux extraterrestres. Cependant, le nickel terrestre est resté méconnu jusqu'en 1751, lorsque le minéralogiste suédois Axel Fredrik Cronstedt a analysé un minerai de couleur cuivrée provenant de Helsingland, en Suède. Ce minéral, initialement rejeté par les mineurs comme du « kupfernickel » ou « cuivre du diable » en raison de son apparence trompeuse, a révélé un métal argenté inconnu après un traitement chimique avec du charbon de bois et de la chaleur. L'analyse systématique de Cronstedt a distingué le nouvel élément des métaux connus, conduisant à sa désignation formelle en tant que « nickel » en hommage au minerai problématique. Le XIXe siècle a vu un développement rapide de la métallurgie du nickel, particulièrement après la découverte de gisements majeurs en Nouvelle-Calédonie (1865) et à Sudbury, au Canada (1883). Les applications industrielles se sont fortement étendues au début du XXe siècle avec l'invention des aciers inoxydables par Harry Brearley et l'essor ultérieur des industries aérospatiales nécessitant des superalliages à base de nickel performants.
Conclusion
La nature multifacette du nickel le positionne comme un élément indispensable dans les technologies modernes et les systèmes biologiques. Le débat continu sur sa configuration électronique souligne la complexité de la chimie des métaux de transition et l'évolution constante de notre compréhension grâce aux techniques spectroscopiques avancées. Les applications industrielles s'étendent continuellement vers les systèmes de stockage d'énergie, les processus catalytiques et l'ingénierie des matériaux avancés, tandis que ses rôles biologiques dans les processus enzymatiques soulignent son importance fondamentale à travers plusieurs domaines du vivant. Les recherches futures porteront sur les méthodologies d'extraction durables, les technologies de recyclage pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, et des applications innovantes dans les matériaux quantiques et les systèmes d'énergie renouvelable. La convergence des propriétés magnétiques, de la résistance à la corrosion et de l'activité catalytique du nickel garantit sa pertinence continue face aux défis technologiques du XXIe siècle.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
